
L’Autre moitié du monde (ed Le Sonneur) est le livre qui consacre Laurine Roux Prix Orange du livre 2022, sous l’égide de Jean-Christophe Rufin et d’une équipe de jurés exceptionnels. A jurés exceptionnels, texte exceptionnel : L’Autre moitié du monde plonge le lecteur dans une tragédie humaine sur fond de guerre d’Espagne. Une histoire puissante sublimée par l’écriture de Laurine Roux, une romancière dont on sait de façon certaine et dès les premières lignes de ce troisième roman, qu’elle est un grand écrivain.
Pour lecteurs.com, Laurine Roux a réservé un moment d’interview dans un emploi du temps chargé notamment par les corrections d’un nouveau livre à paraître à l’automne. On y découvre un écrivain déjà remarquable, une femme poète, aussi, qui porte un regard libre, singulier et charnel sur le monde. A suivre de très près.
- Vous êtes la lauréate du Prix Orange du Livre 2022, comment avez-vous vécu ces mois qui ont suivi la première sélection et les étapes vers la remise du prix ?
Quand j’ai appris que le roman était sélectionné, très honnêtement, je me suis dit que ce n’était pas possible. Puis, d’étapes en étapes, j’ai compris – en lisant des posts sur les réseaux sociaux - que le texte avait emporté les faveurs de quelques membres du jury. Je me suis alors prise à espérer, sans toutefois me faire trop d’illusions. Notamment en raison de l’ultime phase : le vote des internautes. À l’école et au collège, je ne me suis jamais présentée à l’élection des délégués, de peur d’affronter le suffrage de mes camarades. Imaginez-donc là... Et puis j’ai constaté l’immense enthousiasme des lecteurs, la générosité avec laquelle ils ont porté L’autre moitié du monde. J’ai été très émue de cet élan collectif.
- Dès votre premier roman, Une immense sensation de calme (Le Sonneur) en 2018, la SGDL vous consacrait comme sa révélation. Le deuxième, Le Sanctuaire, recevait le Grand prix de l’imaginaire en 2021, et votre troisième, donc, L’Autre moitié du monde est à son tour gratifié du Prix Orange du Livre ! Ces différentes consécrations sont à la fois remarquables dans la vie d’une jeune romancière, mais n’est-ce pas aussi un peu angoissant ou… lourd à porter ?
Comment vous répondre... Je suis à la fois très reconnaissante pour l’attribution de ces prix, tout en essayant de garder la tête froide. J’ai écrit pendant dix ans en étant refusée par les maisons d’édition à qui j’envoyais mes manuscrits. Continuer coûte que coûte dans cette adversité a forgé en moi un rapport encore plus intime au texte, m’a appris que l’écriture ne s’épuisait pas dans les tribulations, que mon plaisir à travailler la phrase, à inventer, à songer, à conter demeurait intact, quoi qu’il arrive. Ce plaisir reste et restera mon ultime récompense.
Le reste, je l’accueille à bras ouverts, tout en me répétant : c’est du bonus, c’est fragile. Je viens des Hautes-Alpes, une terre ancestrale de paysans. On a la patience et l’humilité face aux aléas de l’existence ancrés dans la peau.
- C’est le roman qui vous fait connaître du grand public, mais il semble que vos premières amours aient été portées par la poésie. Pourriez-vous nous dire comment l’écriture est venue à vous ?
L’écriture est arrivée à moi à peu près en même temps que la lecture. Le livre m’a semblé le lieu de la parole précieuse. De l’ubiquité aussi : il permettait de dilater la vie, le temps, les lieux. Très vite, j’ai eu envie de donner forme à de petites histoires. Ma mère a ressorti dernièrement mes cahiers de texte et mes agendas. Aux pages du mercredi et du week-end, tout est griffonné de bricoles.
À l’adolescence, c’est la poésie qui s’est imposée à moi, sous le chaperonnage de Cendrars, Desnos et Hugo. Puis, en découvrant Notre-Dame-des-Fleurs de Jean Genet, Emmène-moi au bout du monde de Cendrars, l’écriture de Colette ou celle de Giono, j’ai aimé retrouver ce modelage poétique de la phrase dans les récits. Les frontières s’abolissaient, les genres s’amalgamaient. Cela a été l’ouverture d’un champ de liberté incroyablement stimulant. Mes romans en portent aujourd’hui la trace. Et, curieusement, la poésie que je pratique est, à l’inverse, empreinte d’une forte dimension narrative.
- Que devient la poésie désormais dans votre trajectoire d’auteur ?
La poésie, au sens large, je la vis au quotidien. J’ai la chance d’habiter un coin de montagne qui m’offre tous les jours des éblouissements, majeurs ou minuscules − les effilochées de nuages au sommet du Pic de Bure, l’apparition fugace d’une bête sauvage, une libellule sur une herbe qui ploie. Immédiatement, il y a une voix en moi qui cherche alors les images, les mots justes. Que je n’écris pas forcément, pour un tas de raisons essentiellement pratiques. Une chose est sûre, cette rumination langagière, ce désir de malaxer la langue pour réduire l’écart entre le mot et la sensation est une manière de lui faire dire ce qu’habituellement elle ne dit pas. Une sorte de ring, de jeu. Auquel je m’adonne plus que volontiers.
Quelque chose m’a frappée ces derniers temps : mes projets narratifs sont souvent couplés à des projets poétiques qui leur sont cousins. Une poésie peut jouer les fantassins ou les voitures balai : elle annonce un récit à venir, ou me permet d’explorer plus librement les obsessions qui m’ont tenue lors de l’élaboration d’un roman. J’ai donc souvent des tandems roman/poésie.
Quant à l’idée de publier un jour mes textes poétiques, je ne m’y suis jamais vraiment attelée sérieusement. Par manque de temps, surtout. Le théâtre La Passerelle de Gap m’a offert la chance travailler sur des créations sonores : j’ai pu lire sur scène certains de ces opus inédits. Les porter en chair et en os, donner de la voix, au sens propre, à un public dont je percevais l’émotion et les réactions à travers la tension ou le frémissement des corps, cela m’a plu. Énormément. Je suis très attachée à l’origine orale de la littérature.
- On trouve dans L’Autre moitié du monde, la présence forte d’une nature à la Giono. Vous me voyez venir, forcément, j’aimerais que vous nous parliez de cet écrivain si important pour vous, et de son éventuelle influence sur votre imaginaire de romancière.
Giono, je le lis depuis mes études de Lettres mais il a occupé mon imaginaire littéraire bien en amont. J’ai grandi à quelques encâblures de Baumugnes, dont il est question dans le roman du même nom, Un de Baumugnes. Je mangeais le fromage de chèvre fabriqué là-bas. Et suis toujours fidèle à cette tomme. J’ai donc mangé Giono avant de le lire, comme j’aime bien le formuler.
Par ailleurs, j’entretiens un lien affectif avec cet écrivain. Inséparable du souvenir de ma grand-mère. Qui connaissait incroyablement bien son œuvre. Et qui avait eu des échanges avec lui, au sujet d’un projet d’autoroute qui menaçait de passer par Baumugnes. Elle ne supportait pas l’idée et avait réuni quantité d’écrits d’auteurs, qui plaidaient la préservation de la nature et du patrimoine culturel que constituait cette vallée et cette montagne.
Ce que Giono m’a appris aussi, c’est qu’écrire est une géo-graphie. Un alphabet de la terre. Je n’en fais pas une loi, mais volontiers une devise personnelle.
- Comment le sujet de ce troisième roman, qui plonge le lecteur dans le fracas de la guerre civile espagnole, vous est venu ?
L’autre moitié du monde, est né d’une émission de cuisine, À pleines dents. Du choc créé par le corps glouton de Gérard Depardieu dans le delta de l’Ebre. Une libido géographique s’est levée : la confluence de l’horizontal et de l’appétit, de l’eau et de la terre, du pâle et de la nervosité des sucs. J’ai rêvé d’une écriture sucrée-salée. L’Espagne a alors convoqué le fantôme de mon arrière-grand-père, qui a aidé à exfiltrer des centaines d'anarchistes sous Franco. Son ombre a engendré des personnages, que j’ai adoptés avec beaucoup de tendresse. Vous voyez, là encore c’est une terre qui enfante, une géo-graphie.
- Emergent de cette époque, qui voit naître la guerre civile, les reliefs d’une société éminemment féodale. Pourquoi avez-vous choisi ce moment de l’histoire pour planter le roman ?
Comme je vous le disais, je n’ai pas vraiment choisi. La chose s’est imposée à moi. De la même manière que j’ai des libidos géographiques, j’ai des libidos politiques. La révolution sociale espagnole de 1936 en fait partie. Elle a souvent été attrapée par son versant urbain, avec des images de Barcelone en pleine effervescence. Mais c’était aussi un soulèvement rural, des expériences collectivistes de la terre − un des cris de ralliement était ¡Tierra y Libertad! Les petites gens, véritablement inféodés, se sont révoltés contre les grands propriétaires terriens, qui régnaient tels des seigneurs sur leurs domaines. Le film Land and Freedom, de Ken Loach m’avait profondément marquée à la fin de mon adolescence. Je crois qu’une graine était semée.
- Le roman sépare deux époques en trois parties avec deux héroïnes, Toya, une jeune fille de la campagne dans les années 30, puis Luz, une jeune femme des années 50. Qui sont-elles ?
Toya c’est une gamine qui vit dans le delta de l’Ebre, une région de Catalogne où le fleuve se jette dans la Méditerranée. Elle est têtue, futée, dégourdie, insoumise, instinctive, animale, et connaît les lieux comme sa poche. Au moment où le destin des siens se mêle au soulèvement social, elle s’engage à corps perdu dans la révolution. Qui va lui offrir ce qu’elle connaîtra de plus cher, tandis que la répression franquiste le lui ôtera. Son existence est régie par deux puissances contraires : Eros et Thanatos.
Luz, elle, vient de Barcelone. Beaucoup plus jeune. Elle se cherche, va être aimantée par le delta et rencontrer Toya qui, sans qu’elle ne puisse se l’expliquer, la fascinera. Mais je ne veux pas en dire plus pour ne pas dévoiler la chair du roman !
- Quel rôle joue l’Histoire dans le drame intime que vit le personnage de Toya. Pourquoi ?
L’Histoire vient percuter l’existence intime de Toya. Pour le meilleur et pour le pire. Elle exacerbe son destin, lui arrache ce qu’elle a de plus précieux, tout en lui permettant d’accéder à une forme d’héroïsme.
Il y a une dizaine d’année, j’ai lu Le bref été de l’anarchie, de Hans Magnus Enzenberger − un collage d’archives qui racontent, de manière plus ou moins convergente, la vie de Buenaventura Durruti, un anarchiste espagnol qui a dirigé une colonne militaire libertaire. Et en parcourant ces témoignages − qui vont d’extraits de journaux de ses camarades à des rapports de police à son sujet −, en débusquant les divergences, j’ai compris à quel point l’Histoire était un agrégat de vies minuscules, de sueurs qui s’amalgament, de rêvent qui se réunissent ou s’entrechoquent. Qu’elle est la somme des histoires de tous, et qu’il existe des zones de flou, de flottement, qui fonctionnent comme des appels d’air pour la fiction.
- L’Autre moitié du monde est-il une tragédie ? On en retrouve les ingrédients : le meurtre originel, la vengeance et la cruauté qui rongent le livre, le contexte d’une insurrection avec des sacrifiés, une femme qui s’affranchit, et la mort.
Oui, j’endosse volontiers le terme. Quand on travaillait sur la quatrième page de couverture, mon éditeur, Marc Villemain, m’a demandé quels étaient les trois mots qui caractérisaient selon moi le mieux le texte. Ce qui m’est spontanément venu c’est : une histoire d’amour, de haine et de mort. Comme vous le dites, ce sont des ingrédients caractéristiques de la tragédie. Ce qui s’est passé en Espagne, en 1936, est intrinsèquement tragique : un peuple qui se libère, qui tâtonne pour s’autogérer, se tient au seuil d’une expérience nationale unique, mais dont la révolution sociale − à cause de querelles de chapelle internes aux appareils politiques, de la peur que l’anarchisme inspirait aux puissances européennes capitalistes et aux partis sur place −, est sabordée, à coups de trahisons féroces. Et cela parce que le danger fasciste semblait moins terrible à certains que l’éclosion d’une société libertaire. Je trouve ça ahurissant. Tragique au possible.
Et ce qui me désole encore plus, c’est que l’Espagne continue d’être en prise avec les fantômes de cette période, où les rêves les plus beaux ont côtoyé la barbarie la plus innommable. Je ne dirai jamais assez la dette que j’ai, dans mon travail de recherche à ce sujet, vis-à-vis du documentaire Le silence des autres, d’Almudena Carracedo et Robert Bahar. Dans lequel on comprend à quel point cette tragédie s’est répercutée de génération en génération.
- La maternité et sa complexité parfois déchirante incarnée par la fidélité au sang jalonnent le livre. Quel regard portez-vous sur ce lien essentiel entre les protagonistes du livre, de la Marquise à Toya ?
Difficile de répondre précisément... Je peux simplement constater que mes romans sont charpentés par des lignées de femmes. Que le sang y est un motif poétique et symbolique fort : le sang de la famille, de la fidélité aux siens, des menstrues, de la violence des hommes. Quand le monde devient chaos, la mère et les grands-mères sont le seul refuge. Leurs voix tiennent debout. Et continuent de bercer. Même par-delà la mort. Pilar incarne parfaitement cette tendresse. J’ai mis beaucoup de mon amour pour ma mère et mes grand-mères dans ce texte. Quant à la Marquise, c’est le versant pathologique de la maternité, de l’aveuglement vis-à-vis de son enfant-roi, qu’on ne veut pas voir comme un monstre.
- Que comprenez-vous de la folie des hommes dans ce moment particulier et finalement peu digéré par la littérature française de cette guerre d’Espagne ? Vous-même, avez-vous eu besoin de vous immerger dans ce contexte historique difficile pour en affranchir cette fiction ?
Avant d’écrire ce texte, je me suis documentée de façon boulimique. J’ai lu une somme conséquente d’essai politiques et historiques sur la période. Puis je me suis permis d’oublier. De faire décanter cette masse. Pour ne garder que ce qui resterait, et serait la charpente chronologique du texte. Ensuite, bien sûr, il y a eu des ajustements, ce qui est le boulot à l’établi de l’écriture, quand on reprend le texte pour le forger, affiner la cohérence temporelle.
Quant à ce que je retiens de la folie des hommes après ce travail autour de cette période... Disons que ce n’est pas pour me rassurer : cette incapacité des Républicains à s’entendre en 1936 résonne tellement avec les errements de la gauche aujourd’hui, avec la montée en puissance des fascismes un peu de partout en Europe.
Je suis très pessimiste sur l’avenir de l’humanité à moyen terme, essentiellement pour des raisons écologiques. Et c’est la folie des hommes, cette hybris, qui nous conduit droit dans le mur – l’appât du gain, celui du pouvoir en sont les meilleurs carburants... En même temps, une parcelle de moi-même voudrait rester naïve, espérer qu’un sursaut soit encore possible. Une chose est certaine : je crois encore aux mots, à la fiction. Aux histoires qui peuvent incarner des idées, se glisser sous la peau du lecteur, le faire suffisamment frissonner pour créer de la pensée. Je ne dis pas le changer. En tout cas, donner une chiquenaude. Je n’écris en revanche jamais pour dire ceci ou cela, délivrer un message. Mes textes sont malgré moi trempés dans ce que je combats, dans ce qui m’indigne, donc politiques.
- Et pour terminer cet entretien par une question qui aurait pu être la première : quelle est l’histoire de ce si beau titre, L’Autre moitié du monde ?
Ce titre m’est arrivé comme un cadeau, lors d’un retour en train chez moi. J’écoutais l’adagio du concerto en ré mineur BWV 974 de Bach, auquel je me suis beaucoup adossée pour écrire le roman - en me coulant dans le rythme, d’abord lent, posé, puis qui s’envole, pour ralentir de nouveau. Je traversais le Trièves, avec les arêtes du Vercors dans mon dos. Et ce titre m’est venu, ne me demandez pas comment. Michon le dit : « Le roi vient quand il veut. » En tout cas, les mots se sont imposés dans leur polysémie : l’autre moitié du monde, c’était l’amour − celui de Toya pour Horacio et d’Horacio pour Toya −, c’était les paysans du delta, petites gens, que les dominants considèrent comme invisibles, c’était aussi la musique et la poésie. Et puis les fantômes : ceux des êtres chers, qui continuent, par leur opiniâtreté, à habiter l’esprit et le monde des vivants. À être vivants.
Propos recueillis par Karine Papillaud
Copyright photo de Laurine Roux : JPLoyer@Presswall.
















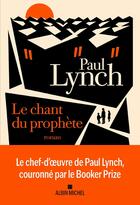




Bonsoir, félicitations à l'auteure!
Le sujet m'intéresse beaucoup.
Très très intéressant se livre ,à découvrir avec plaisir , elle mérite bien son prix rangé du livre ,le thème est prenant bravo a l auteur
super j avais voté pour ce livre :)