
Elle vous dit tout, absolument tout sur son formidable roman, Où passe l'aiguille (Flammarion), récemment récompensé par le Prix des lecteurs du salon du roman historique de Levallois. Véronique Mougin s’est penchée sur l’histoire de l’un de ses cousins, les mains dans les archives familiales, pour retracer un pan de l’histoire européenne récente qui commence en Hongrie, se prolonge tragiquement par les camps de concentration nazis, pour finir dans la lumière coruscante de la haute couture parisienne d’après-guerre. Un itinéraire fantastique, hautement romanesque, dont elle nous révèle les dessous avec passion, générosité et beaucoup de finesse.
- Votre premier roman, Pour vous servir, publié en 2014, raconte les confessions d’une gouvernante après 20 ans de service chez les très nantis de la capitale. Quatre ans plus tard, Où passe l'aiguille (Flammarion) semble un sujet plus historique que social. Qu’est-ce qui vous met à l’œuvre d’un roman ?
L'étincelle, c'est le personnage principal : la rencontre, dans la vie réelle, avec un homme ou une femme épatante et ce sentiment de « tenir » là un héros authentique, courageux, spirituel, auquel le roman rendra justice en retraçant son destin. Méconnu, le destin. J'aime quand l'écriture se met au service des petites gens, les sort de l'invisibilité et/ou leur rend la parole. Ainsi mon livre précédent est-il né d'une enquête sur les domestiques de prestige, pour laquelle il me fallait interviewer diverses employées de maison. J'ai fait de l'une d'elle, merveilleuse de pugnacité et d'humour pince-sans-rire, la narratrice du roman, ce qui me semblait un juste retour des choses après 20 ans de service silencieux... Mon dernier livre, Où passe l'aiguille, met également en lumière un homme de l'ombre (en l'occurrence, mon cousin). Petit Juif indomptable, 14 ans en 1944, Tomas est jeté dans un camp de concentration. Miracle numéro 1 : la baraque 5 est chauffée. Miracle numéro 2 : on y raccommode les uniformes rayés des détenus, le gamin n'y connaît rien mais il adore ça. Tombé fou-amoureux de la couture derrière les barbelés, il devient après la guerre l'un des grands artisans de la mode française. Voilà aussi ce qui m'attire vers tel ou tel sujet de roman : la possibilité de plonger dans les coulisses d'un milieu habituellement inaccessible – ici, la haute couture – et d'y emmener le lecteur avec moi.
- L’enquête est votre compétence première puisque vous êtes journaliste. Toutefois, qu’y a t il de particulier à prendre sa propre famille pour sujet d’enquête ?
Tout est plus intense lorsque l'idée du livre tombe de notre arbre généalogique : la responsabilité, d'abord, de créer un beau récit, séduisant mais fidèle à la réalité. Et puis l'émotion de ressusciter les morts par l'écriture. Le plaisir, aussi, de rendre hommage aux vivants. Mais plus forte que tout, il y a la joie de posséder un matériau unique (souvenirs, photos, archives personnelles), que nous sommes seuls à pouvoir transformer en roman, et qui le mérite. C'est précisément ce qui me plaît dans l'histoire de Tomas : elle dépasse le récit familial. Elle est extra-ordinaire, européenne, résiliente, c'est une vie romanesque comme le XXe siècle a su si bien en fabriquer.
- Une partie de votre livre se consacre à la vie en camp de concentration. Comment avez-vous abordé la question de la littérature concentrationnaire, nombreuse et sacralisée ?
Bien sûr j'ai lu (Kogon, Stern...) et relu (Kertész, Levi, Antelme, Appelfeld...), mais pas uniquement ces classiques. Dans la masse des documents j'ai aussi choisi des ouvrages moins connus d'auteurs amis de mon cousin (Nicolas Roth) ou du même âge (Tomkiewicz), voire du même bourg hongrois (Gryne, Siegal), afin de recouper certaines informations et plus généralement me situer dans la constellation. La question qui habitait ces témoins se pose, avec plus d'acuité encore, aux auteurs de la troisième génération comme moi, auxquels un récit de déportation a été légué : pourquoi le transmettre et comment ? 70 ans après la libération des camps, certaines scènes sont devenues des lieux communs - l'arrivée sur la rampe d'Auschwitz, le rasage... - faut-il repasser en ces lieux littéraires-là ?
Mon cousin, comme nombre de déportés, a conservé une mémoire extrêmement vivace de l'année de ses 15 ans passée dans les camps. C'est d'ailleurs l'un des symptômes du trauma, précision des souvenirs, des noms, des lieux, des sensations. Que garder et qu'élaguer de cette hypermnésie ? La plupart de mes interrogations ont trouvé leur réponse quand j'ai quitté le champ immense de la littérature concentrationnaire pour explorer mon propre sillon, l'histoire unique d'un homme qui ne l'est pas moins. La vie de mon cousin illustre parfaitement la phrase de Sartre sur Genet : « le génie n'est pas un don, mais l'issue qu'on invente dans les cas désespérés. » C'était cela que j'avais envie d'écrire ! Non pas la chronique d'une déportation mais celle d'une vocation, la couture, née paradoxalement dans un camp de concentration.
Le projet littéraire était le suivant : relater la fabrique d'un homme particulier, debout et joyeux malgré tout, ouvrir sa boîte noire, observer les rouages. Par quels miracles ce petit cancre à la langue bien pendue, destiné à devenir plombier au tréfonds de la Hongrie, puis condamné à partir en fumée à Auschwitz, est-il devenu un maître de la haute couture parisienne ? Quand et comment sa vie minuscule s'est-elle transformée en destin ? A quels moments précis son existence a-t-elle basculée ? Grâce à quelles rencontres fondatrices ? Une fois retaillée aux mesures de mon projet, la question « qu'écrire ? » se résolvait : il me fallait raconter ces instants-là, les instants-clés, et seulement ceux-là. Ainsi mon récit s'articule-t-il autour de ces points cruciaux. Le héros, Tomas, laisse alors la parole à un autre narrateur, celui qui, pour le pire ou le meilleur, change sa vie par un mot, un geste, une décision : le kapo qui l'affecte à l'atelier de couture, le médecin qui le sauve, le patron qui lui donne sa chance à la libération, sa future femme... C'est en déroulant son propre fil, me semble-t-il, que cette histoire parvient à toucher le public - de quels nœuds particuliers nos vies à nous sont-elles tricotées ?
- Vous auriez pu raconter la biographie de votre cousin, mais vous avez choisi la voie du roman. Pourquoi ?
Pour la liberté qu'il offre, justement : couper, zoomer, faire entendre différentes voix pour rompre la monotonie, alléger le propos par l'humour... En regard, la biographie me semblait une option à la fois rabâchée, et narrativement plus terne. Ecrire au passé, adopter un surplomb rétrospectif, comportait le risque d' « aplatir » les rebondissements de l'histoire, pire : de la rendre poussiéreuse... Le héros a 14 ans au début du récit, et aujourd'hui, quand un lecteur entend le triptyque « adolescent-juif-1944 », il risque de s'imaginer un enfant triste et sage dans un shtetl désolé, comme une photo en noir et blanc de Roman Vishniac... Or, mon héros, Tomas, est tout l'inverse. Ni triste, ni sage. Il ne pense qu'au foot, aux filles et au cinéma, il faut le traîner par les cheveux pour aller à la synagogue. Il est anticonformiste, tête-à-claques, bagarreur, bref : il est de notre temps. Ce qui lui arrive ainsi qu'à sa famille (brimades, relégation) a également des accents contemporains.
Pour coller à cette modernité du personnage et rendre son histoire séduisante, notamment aux yeux des plus jeunes lecteurs peut-être moins sensibles à cette question que nous l'étions à leur âge, il fallait écrire en couleurs, et non en noir et blanc. Faire entendre la voix de ce gamin gouailleur qui, au fil des pages, devient homme. Mettre nos pas dans les siens, découvrir la vie à travers ses yeux. J'avais donc besoin des outils de la fiction : une narration au présent et à la première personne du singulier, des dialogues, des remises en scène...
En résumé, le roman me permettait de « raconter bien », comme le souligne Jorge Semprun dans L'écriture ou la vie, « raconter bien, ça veut dire : de façon à être entendus. On n’y parviendra pas sans un peu d’artifice... » Exemple : lors de nos entretiens préalables à l'écriture du livre, mon cousin m’avait raconté que ses parents, juste avant d’être envoyés dans le ghetto, ont vendu quelques-uns de leurs biens, échangé cet argent contre des dollars et un peu d'or, puis caché le tout au fond du puits afin d'éviter la spoliation.
Si j'avais écrit la biographie de mon cousin, sans doute serais-je passée rapidement sur cet événement auquel il se souvient vaguement avoir assisté. Dans le roman, au contraire, l'épisode prend du relief. Voici donc le héros et son petit frère, cachés derrière le rideau de la salle à manger, stupéfiés par l'irruption sur la table familiale d'un vrai trésor, fascinés à l’idée que ces dollars ont vu l’Amérique, la statue de la liberté voire même ces plaines du Far-Ouest qu'eux ont découvert sur grand écran et dont ils ne peuvent que rêver, maintenant qu'ils sont cloîtrés chez eux et interdits de cinéma... Que deviendra cet argent une fois jeté au fond du puits : va-t-il se casser, fondre, rouiller ? Cette question qui les tracasse - que se passe-t-il quand on disparaît ? - résonne avec leur destin en train de se jouer.
L'écriture littéraire, ici à hauteur d'enfant, permet de déployer l’imaginaire des personnages, d'ajouter de la chair et du sens, de jouer sur l'émotion, en espérant que le lecteur s'amuse aussi... Liberté chérie du roman !
- Une bonne partie de votre roman se déroule à Paris, le lieu de la liberté retrouvée après-guerre. Comment s’incarne-t-elle pour votre héros ?
Tomas a 17 ans à la libération. Il n'a plus de patrie, pas de papiers. Il rêve de New York mais le passeur le jette dans un claque près de la République – terminus ! A peine de quoi manger, plus un sou en poche mais le môme s'en moque, bon sang, puisqu'à Paris il y a les Parisiennes ! Les Parisiennes et leurs jambes nues, leurs petits pieds gracieux perchés sur des talons qui résonnent dans des rues sans pogrom, les Parisiennes et leurs petites culottes qui sèchent aux fenêtres... Et quelle diversité ! Il y en a partout, des filles, en France, et pas que des filles, des mères aussi, des cousines, des blondes, des brunes, toute la gamme, pas comme chez lui, en Hongrie, dans son quartier où les femmes ont presque toutes disparu...
Ici, Tomas peut même les observer, en détails, dehors, aussi longtemps qu'il le souhaite, sans baisser les yeux, sans se faire tabasser, même s'il est juif, tout le monde s'en moque à Paris, il a le droit de regarder les filles, voilà la liberté toute crue. Tomi en profite. Il y passe des heures, il y a tant à admirer, les robes corolles de quarante mètres d'envergure, la taille serrée, les épaules rondes à croquer, après les restrictions de l'occupation ces dames ont faim de mode, le New Look les sublime, la mode française renaît, partout on cherche des tailleurs, des apiéceurs, des finisseurs, des modélistes, des brodeurs...
Tomas trouve dans la haute couture une véritable terre d'asile, comme bien d'autres réfugiés. Hongrois, Tchèques, Polonais, Russes, apatrides : les ateliers regorgent de petites mains étrangères dont le patron se moque qu'elles soient juives, athées ou sikhes, pourvu qu'elles servent avec talent le culte des aiguilles. C'est cela, Paris, pour mon héros, dès 1946 et pour des décennies : la liberté laïque, sensuelle, réjouissante d'être soi et d'aimer, la possibilité de vivre sa vie, de la gagner, de la réussir. Paris, finalement, c'est l'Amérique en mieux.
- On sent dans le livre que vous avez pris du plaisir à l’écrire…
Beaucoup de plaisir, oui, particulièrement dans les chapitres consacrés à la haute couture. La maison de mode est un pays, avec sa langue, ses coutumes, ses parfums, couleurs, matières, il y a un exotisme total de cette création, le traduire est un régal. Et ses habitants ! J'aime énormément l'exercice du portrait, « attraper » un personnage par ses angles, ses manies, le lot particulier des névroses qui le constituent et qui permettent à l'écriture de cheminer sur la crête entre tragédie et comédie.
Les fêlés, les excentriques, ceux qui ont un grain plus ou moins gros, font mon bonheur. Avec les gens de la mode, je me suis régalée. Mais le plus réjouissant a été d'accompagner mon personnage, Tomi, vers le grand âge, le vieillir par petites touches, laisser deviner le gamin déluré derrière l'homme mûr. J'ai aimé montrer comment la couture (en réalité, la pratique et la fréquentation de la beauté), après l'avoir sauvé dans sa jeunesse, lui a longtemps permis d'être consolé et même mieux : heureux.
Vos avis sur le livre : https://www.lecteurs.com/livre/ou-passe-laiguille/4986135
Vous pouvez également revoir ou découvrir la bibliothèque idéale de Véronique Mougin.

















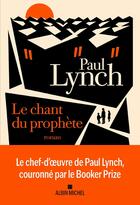



Livre sentimentale et sa position de juif qui en dit long sûrement très prenant il fait partie de mes choix aussi ....