« Jamais j’oublierai les chaussures vertes de Chepe Molina »… Les pompes en serpent, trop classe ! A Villeradieuse (quel nom !), Colombie, on peut s’habiller des pieds à la tête, pour trois fois rien grâce au croquemort qui refourgue les fringues « tendance » des morts (prématurément et...
Voir plus
« Jamais j’oublierai les chaussures vertes de Chepe Molina »… Les pompes en serpent, trop classe ! A Villeradieuse (quel nom !), Colombie, on peut s’habiller des pieds à la tête, pour trois fois rien grâce au croquemort qui refourgue les fringues « tendance » des morts (prématurément et violemment). La mode (enfin, celle du coin, plutôt bling bling) à la portée du premier petit blaireau qui voudrait frimer comme les copains. Le must de l’économie circulaire, des nippes somptueuses, à peine trouées, percées ou délicatement déchirées aux quelques endroits qu’une lame ou un projectile a perforés. A ce détail près, comme neuves, on vous dit.
Voici un sommet d’humour noir, une réflexion acide sans aucune complaisance sur le monde des narcotrafiquants, ses caïds, ses hommes de main et tous ceux qui rêvent de le devenir. A travers le narrateur, jeune rêveur désoeuvré, on perçoit la désolation d’une société où l’unique ascenseur social est le crime. Tout y est : le défilé du petit peuple sous le joug des narcotrafiquants, le club de foot qu’ils financent, les tueurs drogués et stupides, la mère courage qui n’a plus peur à force d’avoir eu trop peur trop longtemps, les gamins qui rêvent de porter les mêmes fringues que les sicarios. Les flics, les avocats, les politiciens, toute une faune bien nourrie, occupée à obéir à ceux qu’elle devrait neutraliser : les caïds qui réussissent. Toujours les plus violents, les plus déterminés, les plus cruels, les plus inhumains.
On imagine, en creux (et à travers le personnage de Lorena, la belle qui ne cède pas au Patron), le calvaire de ceux qui, obligés de vivre dans un tel cloaque, tentent de rester droits et honnêtes, de vivre une vie à peu près normale. Et au final, on se pose une dernière question, la question qui tue (elle aussi) : quid de la responsabilité du consommateur lambda ou des happy few qui consomment de la cocaïne sans chercher à savoir comment elle est parvenue jusqu’à eux, combien de douleur et de chagrin, elle a déjà causé ?
Le Mort était trop grand est une charge féroce et sarcastique sur l’enfer que le trafic de drogue a installé dans le pays de l’auteur. Pourtant, et c’est sa force, ce roman est une farce éblouissante, un cocktail enivrant de saynètes désopilantes, de dialogues hilarants à travers le regard et les pensées d’un petit branleur sans le sou qui vit aux crochets de sa mère et qui prend des airs dans des fringues de marque. Le personnage de don Efrem est l’archétype du mafieux qui a réussi parce qu’il est plus violent, plus outrancier, plus cruel, plus cupide que les autres. Plus malin, peut-être aussi ? Pas vraiment, c’est un assassin ignare, stupide, grossier et l’auteur ne lui fait aucun cadeau. « Des gens cultivés travaillent sous mes ordres. A quoi ça me servirait, bordel, d’avoir de la culture ! »
Dans une inventivité permanente, colorée et musicale (très cinématographique), le texte est truffé de bons mots et de clins d’œil savoureusement décalés. On pense à Balzac (la description longuette de l’épicerie de dona Gloria confinée dans un garage, sorte de pension Vauquer en miniature colorée) ou à Molière et son Bourgeois Gentilhomme. Même si le Monsieur Jourdain de Rivas, narcotrafiquant de son état, n’a rien d’un gentilhomme, même si sa prose est à vomir, pour séduire la belle et inaccessible Lorena, comme Jourdain qui soupirait pour la marquise, il s’en remet, lui aussi, à la culture et à la poésie.
Les dialogues fleurissent, impayables. Il y en a pour tous les personnages, y compris les seconds rôles, au bistrot où les vieux plastronnent et pérorent, avec les tueurs qui, apercevant les fringues de leur dernière victime sur le dos d’un jeune blanc bec, se croient victime d’un revenant, à la morgue où on a installé un salon d’essayage.
Le Mort était trop grand est tout simplement ma meilleure lecture de l’année. En 2011, à la foire du livre de Guadalajara, on avait désigné Rivas comme l’un des « 25 secrets les mieux gardés d’Amérique latine ». Les secrets sont faits pour être dévoilés, c’est fait.



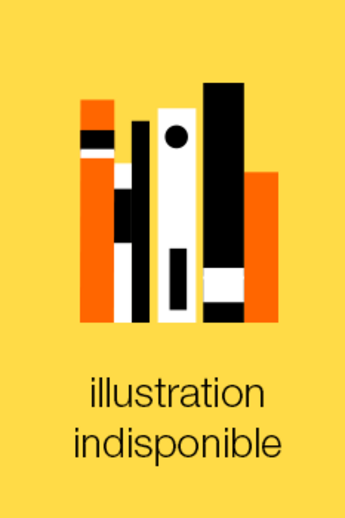












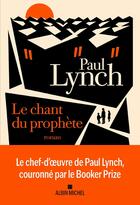



Très jolie chronique ;)
Merci pour ce commentaire. Quant à votre avis, je comprends que le langage et les traductions délicates de chansons colombiennes puissent gêner. L'essentiel étant bien votre conclusion " s'en faire une idée en le lisant". La mienne étant faite, j'espère que de nombreux lecteurs me suivront.
Cordialement.
J'ai aimé lire cet avis... Je ne le partage pas du tout. Mais il donne un autre éclairage que mon regard sur ce livre. Comme je terminais ma chronique: 'A chacun de s'en faire une idée en le lisant!"