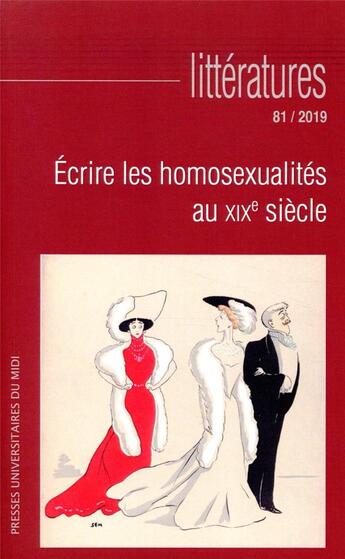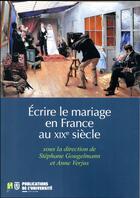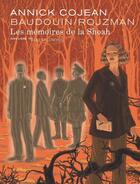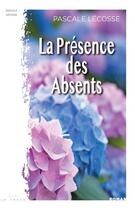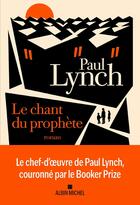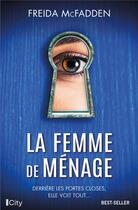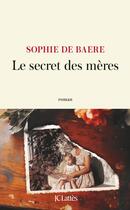-
Date de parution : 16/04/2020
-
Editeur :
Pu Du Mirail
-
EAN : 9782810706778
-
Série :
(-)
-
Support :
Papier
Résumé:
De la Révolution à la Grande Guerre, la littérature en France a reconfiguré le désir pour le même sexe. Elle a doté les personnages d'homosexuel(le)s d'une histoire, en a dessiné le portrait moral et physique. L'écriture contrainte et allusive, qui travaille dans les interstices de la langue et,... Voir plus
De la Révolution à la Grande Guerre, la littérature en France a reconfiguré le désir pour le même sexe. Elle a doté les personnages d'homosexuel(le)s d'une histoire, en a dessiné le portrait moral et physique. L'écriture contrainte et allusive, qui travaille dans les interstices de la langue et, le plus souvent, aux marges des intrigues, est prise entre deux écueils : celui de la censure, qui vise à anéantir une réalité en lui déniant un nom, et celui d'un vocabulaire qui nomme celle ou celui qui aime un être de son sexe par les mots de la damnation (sodomite) ou de l'opprobre (gouine, gougnotte), puis de la pathologie (l'inverti). Balzac, Dumas, Lamartine, Sand, Flaubert, le jeune Mauriac et d'autres encore jouent avec les poncifs en suggérant d'autres sexualités que l'hétérosexualité, d'autres affinités que l'entente conjugale.
Ce numéro examine les stratégies par lesquelles, au XIXe siècle, le roman, le théâtre, la poésie ou les correspondances ont nommé l'innommable et donné, par la fiction, une existence à l'homosexuel(l)e.
Donner votre avis