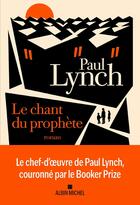De la ruée vers l’or à l’impasse climatique : après il y a deux ans le récit de la genèse de Sophia-Antipolis, c’est maintenant l’histoire de la ville d’Oroville, en Californie, qui permet à Nina Leger d’illustrer l’évolution de l’humanité depuis ses élans pionniers et sa confiance dans le...
Voir plus
De la ruée vers l’or à l’impasse climatique : après il y a deux ans le récit de la genèse de Sophia-Antipolis, c’est maintenant l’histoire de la ville d’Oroville, en Californie, qui permet à Nina Leger d’illustrer l’évolution de l’humanité depuis ses élans pionniers et sa confiance dans le progrès jusqu’à la douloureuse prise de conscience des effets destructeurs de son aveuglement.
Fondée en 1848 au moment de la ruée vers l’or en Californie, Oroville est aujourd’hui connue pour le barrage qui porte son nom. Le plus haut des Etats-Unis et le plus grand au monde au moment de sa construction, il fut érigé en 1968 en complément du Central Valley Project, un programme fédéral conçu dans les années trente pour réguler et stocker l’eau qui inonde alors régulièrement la Californie du Nord, et alimenter le Sud désertique au moyen d’un gigantesque « escalier électrique » composé d’aqueducs, de stations de pompage et de centrales hydroélectriques.
Tout commence lorsque de l’or est découvert dans l’American River. Feu de paille faisant la fortune de quelques uns et la défaite de nombreux autres, la ruée vers l’or initie en réalité la transformation du pays. On dompte d’abord l’eau pour les activités aurifères, puis hydroélectriques, et de fil en aiguille, l’on en vient à « faire couler les rivières à l’envers », transformant le Sud semi-aride de la Californie en riche région agricole où grandes villes et industries se développent. A l’époque, peu importent les dommages collatéraux sur les paysages, la faune et les populations amérindiennes que l’on a de toute façon entrepris d’éradiquer au nom du progrès : « Kennedy n’entendait pas céder à l’impudence des déserts. Depuis quand reculait-on devant les caprices du climat ? N’avait-on pas appris à résister, à modifier, à maîtriser pour posséder, à posséder par la maîtrise ? » C’est ainsi que, siphonnant toujours plus d’eau autour d’elle, la Californie devenue paradis de la high-tech s’est peu à peu enfermée dans une impasse où dérèglement climatique, sécheresses et mégafeux n’ont pas fini leurs ravages.
Nina Leger nous raconte cette histoire par les deux bouts, tissant habilement deux fils narratifs qui finissent par se rejoindre. Côté passé, les événements s’enchaînent au travers d’une galerie de personnages aux ressentis contrastés, géologue, ingénieur et entrepreneur face à trois garçons qui, telles des incarnations de leur pays, feront, non sans culpabilité ni mélancolie, l’apprentissage de la modernité au détriment de leur vie d’avant. Côté présent, sur le fond anxiogène du risque de rupture du barrage d’Oroville dont il fallut évacuer la population en 2017 et des ravages des mégafeux comme le Camp Fire en 2018 et le Bear Fire en 2020, Thea, venue s’occuper des saumons que les incubateurs ne parviennent pas à sauver de l’extinction depuis que « l’escalier électrique » les empêche de se reproduire en rivière, échange lettres et messages audio avec sa grand-mère, tout en s’entretenant avec une amie d’ascendance amérindienne. Entre l’expérience de la grand-mère – l’auteur de science-fiction Ursula K. Le Guin, fille de l’anthropologue Alfred Kroeber et de l’écrivain Theodora Kroeber – et celle de l’amie Susan, se creusent encre une fois hontes et culpabilités alors que l’une et l’autre reviennent à leur façon sur le destin de celui qui, capturé à Oroville, finit ses jours comme sujet d’étude au musée d’anthropologie de San Francisco : il était « le dernier des Yahi », l’ultime survivant de sa tribu et même des « Indiens sauvages » de Californie.
Documenté et brassant les points de vue, le texte doux-amer aux accents volontiers sardoniques explore son sujet sous toutes ses faces en y intercalant, reflets authentiques des opinions et des mentalités du moment, des extraits toujours frappants, souvent choquants, d’articles et de déclarations de chaque époque. Qu’elle est donc révélatrice, cette mise en perspective, de nos aveuglements d’humains cupides et présomptueux, capables au nom de ce qui faisait figure de progrès de détruire sans un regard une terre et ses habitants d’origine… Il n’est pas jusqu’au rythme travaillé dans ses sauts de ligne en cours de phrase pour exprimer le désarroi et le vacillement, du lecteur comme des personnages, face à tant d’aveugle arrogance et d’entêtement dans l’absurdité. Et pourtant, que faisons-nous de ce pesant héritage ? Continuerons-nous cette course en avant jusqu’à nous retrouver nous-mêmes sujets d’études des anthropologues de demain ? Comment sortir de l’impasse ?
Passionnant de bout en bout, ce roman historique qui réussit une mise en perspective particulièrement frappante et édifiante de nos erreurs et aveuglements quant à la notion de progrès ouvre une mine de questionnements d’une brûlante actualité. Combien d’autres « Californies » passées, présentes et à venir ?