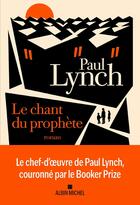Drôle de parcours que celui de Rachel Khan, qu’elle raconte dans Les grandes et les petites choses (Anne Carrière). Noire de peau et juive de confession, étudiante brillante et championne de France du 60 m en salle et du 4x100 m en équipe, elle raconte le moment où sa vie bascule, à 18 ans, quand elle découvre qu’il faut choisir un camp pour s’intégrer dans la société française.
Les Grandes et les petites choses est un texte frais, bourré d’énergie, qui raconte le parcours singulier d’une jeune femme attachante et nuancée qui a choisi la vie, l’amour et le bonheur, avec détermination et enthousiasme.
- Dans Les Grandes et les petites choses, l’histoire est celle d’une héroïne qui s’appelle Nina Gary. C’est aussi votre nom de comédienne. Quelle distance existe-t-il entre vous et votre héroïne ?
J’ai vraiment écrit ce livre en me mettant à la place de la comédienne que je suis. C’était plus facile de me projeter dans ce moi de comédienne, pour avoir la distance de l’écriture, tout en étant profondément dans mon rôle. Dans la vie, on joue tous son propre rôle, non ?
- C’est donc votre histoire ?
Oui. Tout ce qui concerne le personnage de Nina, c’est mon histoire. Mais elle est très empreinte de fiction notamment pour les personnages qui entourent l’héroïne. Par exemple, le bel athlète appelé Jackson est composé à partir de plusieurs personnes qui ont jalonné ma vie, tout comme le professeur de fac d’Assas, Chauvel. Je me suis replongée dans mes souvenirs de jeune fille mais avec mon expérience de femme, en mettant en perspective l’année 1995-96 avec ce que nous vivons aujourd’hui.
- C’est l’histoire d’une jeune femme déchirée entre ses appartenances, à la fois africaines et juives, avec l’ascendance de la Gambie par le père et de la Pologne par la mère. Pourtant, cette question ne semble pas l’avoir effleurée avant la fin de l’adolescence…
C’est lorsqu’elle va sortir du cocon familial qu’elle va découvrir que les communautés sont cloisonnées, a priori selon qu’on est blanc, noir, juif. Elle vient d’une famille bizarre où règne toutefois une entente parfaite entre une mère libraire, un père professeur d’anglais à l’université, et un grand père qui parle yiddish. Elle tient pour normal une situation en réalité profondément singulière dans l’équilibre serein qui en constitue le socle. Mais d’une certaine manière, je perpétue la tradition familiale, puisque mon mari est arabo-andalou. On continue les mélanges !
- Il y a un drame violent qui arrive dans ce livre. Vous choisissez le silence, pourquoi ?
Par rapport au titre du livre auquel je tiens beaucoup, je me suis demandé si ce qui m’est arrivé était une grande ou une petite chose. Avais-je le droit de dire ma souffrance, alors que ma mère, juive, a été cachée pendant la guerre et a perdu sa famille dans les camps ? Le summum de la souffrance pour moi, c’est la Shoah et cette violence m’a été transmise par ma mère. Dans le livre, j’ai voulu mettre en perspective le viol, l’esclavage qui a marqué les origines de mon père et la shoah. Y a –t-il une hiérarchie ou pas ? Il fallait que Nina dépasse tout cela et trouve la rage au fond d’elle pour surmonter et se relever. Mais le personnage du fait de l’histoire n’a pas pu le faire en famille, elle va vivre chez une amie quelque temps. Pour revenir à la réalité, je ne me sentais pas autorisée à vivre cette souffrance au sein de ma cellule familiale en raison de toutes ces questions, de ce passé que je viens d’évoquer… comme une indécence.
- Le fait de provenir d’un bon milieu social ne semble pas vous apporter de solution...
La couleur de la peau renvoie à un certain milieu social et éducatif de fait. Vous avez à prouver constamment et pied à pied ce que vous êtes car il y a une dévalorisation sociale d’emblée. C’est un chemin de déconstruction à faire faire inlassablement à votre interlocuteur. J’avais un grand désir d’écrire ce roman : j’aurais pu choisir l’oralité d’un album de chansons, par exemple, mais j’ai préféré la forme écrite, plus « judéo chrétienne ». Le fait même d’écrire un livre est le moyen de prouver que je viens aussi de l’écrit.
- Vous semblez avoir souffert de la conformité qu’exige la société : vous appartenez à plusieurs cases, juive ET noire, athlète et intellectuelle.
La question est celle de la légitimité et de la place. En fait j’ai vraiment choisi d’être bien dans mes baskets, en m’affranchissant le plus possible du regard des autres. Pour cela, le corps m’a été utile : le souffle, l’adn, pour revenir à quelque chose de scientifique, de moins subjectif donc de plus solide qui m’était nécessaire pour me construire. Pour m’assumer telle que je suis. C’est comme ça aussi que j’aborde mon travail de comédienne, par le corps et ainsi, en allant de rôle en rôle, on arrive à se trouver.
- Dans le roman, votre héroïne se demande si on peut écrire sur autre chose que la négritude quand on est noir. Comment y répondez-vous ?
En fait je ne sais pas. Tant que la question de l’égalité réelle n’est pas résolue et que le stylo est un outil pour battre l’intolérance, je ne sais pas si on peut écrire sur autre chose. La question reste suspendue pour moi. Ce livre n’est pas qu’un livre sur la négritude et le judaïsme, c’est un livre offert à la littérature française. Un hymne à la France.
Un livre d’amour familial aussi !
Un hymne à ma famille et aux personnes que j’aime ! Vous savez, mes parents se sont rencontrés dans la librairie de ma mère. J’ai toujours considéré que j’étais un peu née dans un livre : écrire ce récit était une façon de redonner à mes parents quelque chose comme le prolongement de moi même qu’ils avaient eux mêmes crée. Mes parents ont été bouleversés par le livre. Mon père a changé de façon extraordinaire depuis sa lecture : maintenant il parle ! Il arrive à me transmettre son amour de façon plus fluide et évidente, alors qu’il collectionne les dictionnaires et les silences. Ma mère, aussi, qui est toujours au fond restée une enfant cachée, illégitime : son identité profonde et sa beauté est enfin clamée et consacrée dans un livre.
- Votre prochain film, Lampedusa (réalisé par Marco Pontecorvo), sera diffusé en mars 2016 par la Raï Uno, en Italie. Etre comédienne est-il une façon de vous engager ?
Il y a une phrase d’Aimé Césaire que j’aime bien qui dit que les artistes sont les législateurs de l’ombre. J’ai été confrontée à la politique pendant 10 ans en travaillant dans des cabinets. J’ai quitté ce métier pour que l’art devienne mon outil idéologique, car je me suis aperçu que si les artistes ne sont plus là, le pire est à craindre.
Ce film, Lampedusa, a été une sacrée expérience. Je ne pourrai jamais avoir de rôle dans un film sur la Shoah en raison de la couleur de ma peau. Cette histoire de migrants, c’est finalement l’histoire de ma mère et l’histoire de mon père conjuguées.
Propos recueillis par Karine Papillaud