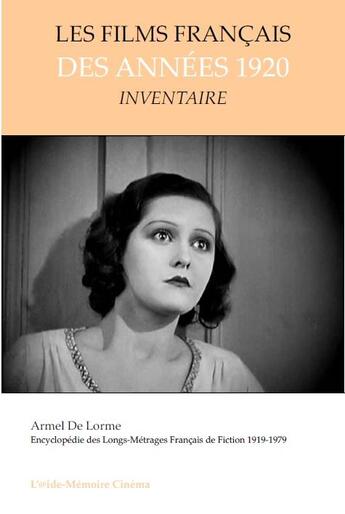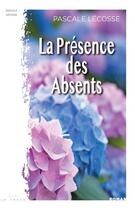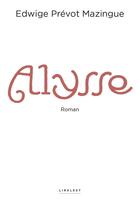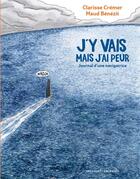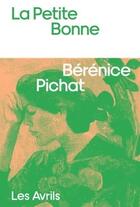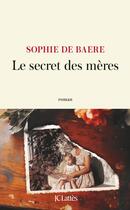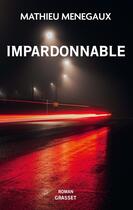Résumé:
Les Films français des Années 1920 (Inventaire) constitue le premier inventaire exhaustif « papier » de la production cinématographique hexagonale 1919-1929, depuis la parution des travaux - jamais réédités - de Raymond Chirat et Roger Icart publiés par la Cinémathèque de Toulouse en 1984, que... Voir plus
Les Films français des Années 1920 (Inventaire) constitue le premier inventaire exhaustif « papier » de la production cinématographique hexagonale 1919-1929, depuis la parution des travaux - jamais réédités - de Raymond Chirat et Roger Icart publiés par la Cinémathèque de Toulouse en 1984, que nous nous sommes efforcés de compléter, de nettoyer de nombreuses erreurs, parfois grossières, et, surtout, de réactualiser.
Ce répertoriage en règle des oeuvres de cinéma produites en France au cours des (riches) Années 1920 a pu être établi à partir de visionnages sur copies et d'un recours au matériel publicitaire d'époque (ce dans la mesure du possible), comme par un dépouillement systématique de la presse corporative et quotidienne d'époque.
De facto, chaque notule comporte les génériques techniques et artistiques - revisités pour la plupart d'entre eux - et le résumé détaillé des films concernés, ainsi certain nombre d'« à-côtés » visant à replacer ces oeuvres dans leur contexte. L'ensemble s'accompagne d'un vaste « panorama critique » permettant de revisiter chacun des titres présentés au prisme des regards croisés des chroniqueurs - souvent talentueux, parfois paresseux, dans certains cas partisans - les plus importants ou les plus influents parmi ceux que comporte cette décennie, qui coïncide, comme le firent judicieusement remarquer en leur temps René Jeanne et Charles Ford, avec l'apogée du cinéma muet en France.
Cette décennie 1919-1929 (ou, dans les faits, plutôt 1918-1930), qui est parvenue à concilier de façon plutôt heureuse cinéromans populaires et grands « films d'auteur » (notion jusqu'alors inconnue), est marquée par la disparition, à quelques années d'intervalle, des « deux Louis » (Delluc et Feuillade), mais également, et avant tout, par l'avènement de cinéastes essentiels qui, chacun à sa manière, marqueront l'Histoire des premières années du Parlant, Jean Renoir, Jean Grémillon, Jean Epstein, Raymond Bernard, René Clair, Julien Duvivier, Marcel L'Herbier et Victor Tourjansky en tête, comme par la confirmation des promesses, détectables, dès leur premiers essais cinégraphiques, parfois anciens, de réalisateurs et réalisatrices de la trempe d'André Antoine, Jacques de Baroncelli, Jacques Feyder, Abel Gance, Maurice Tourneur ou Germaine Dulac.
Elle voit également l'industrie cinématographique accorder une place encore un peu chiche aux « femmes cinéastes », bien plus nombreuses cependant qu'elles ne le seront au cours des trente premières années du Parlant, et nouveaux talents émerger, de façon plus ou moins durable, face à la caméra. Si elle s'accompagne notamment du déclin progressif ou la disparition brutale de bon nombre de valeurs jugées sûres tout au long des années 1920, à commencer par les acteurs d'origine russe de la prospère et innovante firme « Albatros », la fin du Muet n'entrave cependant en rien l'ascension (prévisible) d'artistes aussi emblématiques du cinéma français des années 1930 (et, parfois, bien après) que le seront Marguerite Moreno, Gaby Morlay, Françoise Rosay, Annabella, Pierre Blanchar, Charles Boyer, Victor Francen, Pierre Fresnay, Albert Préjean, Michel Simon ou Charles Vanel.
Les oeuvres abordées dans le présent volume, lorsqu'elle n'ont totalement disparu des radars, ne sont guère accessibles, dans leur très grande majorité, qu'aux seuls chercheurs, ce dans des conditions pas toujours pratiques ou confortables. C'est, au-delà de leurs qualités comme de leurs défauts, l'une des raisons majeures nous ayant poussé à les refaire revivre « autrement », en privilégiant, naturellement, le support « film » dans la mesure du possible, mais sans négliger pour autant le support « non-film », indispensable à l'édification de toute « Histoire du Cinéma » qui se respecte. Au moment d'entreprendre ce nouveau projet éditorial de « L'@ide-Mémoire Cinéma », il nous est apparu qu'entreprendre un travail de ce type, une fois tous les quarante ans, ne relevait pas nécessairement du luxe. Ce premier opus sur le point de paraître, ce qui n'était jusqu'alors qu'une intuition est devenu une absolue certitude.