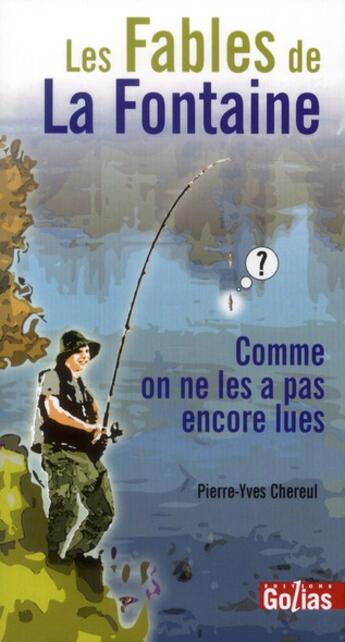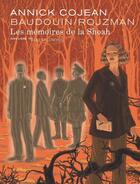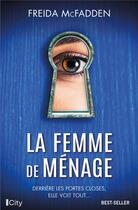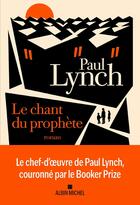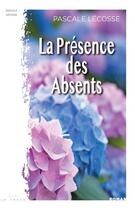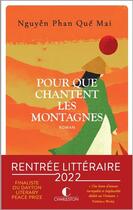-
Date de parution : 01/03/2012
-
Editeur :
Golias
-
EAN : 9782354721589
-
Série :
(-)
-
Support :
Papier
Résumé:
Les « Fables » de Jean de La Fontaine peuvent-elles encore recèler aujourd'hui un enseignement que l'on aurait jusqu'ici méconnu ? Ce serait prétentieux de l'affirmer. Elles ont été, depuis le 17ème siècle, tellement auscultées sous toutes les coutures. On s'est intéressé à l'auteur, le prétendu... Voir plus
Les « Fables » de Jean de La Fontaine peuvent-elles encore recèler aujourd'hui un enseignement que l'on aurait jusqu'ici méconnu ? Ce serait prétentieux de l'affirmer. Elles ont été, depuis le 17ème siècle, tellement auscultées sous toutes les coutures. On s'est intéressé à l'auteur, le prétendu « bonhomme » La Fontaine, distrait et rêveur, dit-on, comme un stéréotype campe « les poètes » ; puis on a recensé ses sources, tous ces auteurs anciens ou plus récents auxquels il n'a pas hésité à emprunter le sujet de ses histoires. On a exploré son « monde » littéraire, son style, sa poésie, que certains appellent sa « poétique », ou encore ses recettes de fabrication, la « genèse » de ses fables. On s'est extasié devant le « peintre animalier ». On a tenté de déchiffrer sa philosophie, samorale ou encore sa politique à la faveur des leçons de ses fables qui offrent autant d'objectifs que demoyens à l'action. Sauf erreur, cependant, il ne semble pas que l'on se soit jamais interrogé sur l'école de l'information que sont ses fables.
Donner votre avis