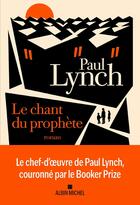La littérature argentine anime le salon du livre de Paris du 21 au 24 mars 2014. Plus dinfo ici.
Elle est protéiforme, violente, poétique, incroyablement imaginative, cisaillée par la dictature de la fin des années 70 ; elle renouvelle les genres du roman et de la nouvelle depuis Julio Cortazar en passant évidemment par Borges. Marquée par l’histoire de son pays, la littérature argentine se vit pourtant droit dans son présent, échappant aux sirènes ronronnantes de la célébration d’un panthéon d’auteurs devenus universels. Les écrivains qui la portent aujourd’hui sont des créateurs d’une littérature captivante qui ne ressemble à aucune autre.
Ils sont 40 auteurs invités par le salon, venus fêter à Paris le centenaire de la naissance de Cortazar et rencontrer les publics français. Laura Alcoba, Selva Almada, Hernàn Brienza, José Pablo Feinmann, Martin Kohan, Elsa Osorio ou encore l’étonnante Samanta Schweblin sont parmi les incontournables d’une littérature qu’Anne-Marie Métailié, l’éditrice des éditions éponymes qui fêtent leur 35e anniversaire cette année, décrit comme « un melting pot original, créateur d’une pensée et de talents qui s’enrichissent plus qu’ailleurs en Amérique latine » (voir entretien).
-Vous publiez une douzaine d'auteurs argentins. Parmi eux, Pablo de Santis, Selva Almada, Elsa Osorio et Mempo Giardinelli sont invités au Salon du livre. Qu’est-ce qui vous séduit dans la littérature argentine?
Il est compliqué de répondre précisément à cette question, car je ne raisonne pas en terme de littérature nationale. Chaque littérature de chaque pays présente des mouvements, des courants ; ils sont nombreux et différents en Argentine. Mais je peux dire que je suis séduite par la littérature de l’Amérique latine. Pour moi l’essentiel, le ciment d’une littérature, c’est la langue. La langue espagnole, telle qu’elle s’est constituée sur le continent sud-américain, a des caractéristiques très différentes de celle de l’Espagne et par conséquent il y a en Amérique latine une plasticité spécifique dans les différentes manières d’écrire. Et c’est ce que j’aime.
-Qu’est ce qui donne à Julio Cortazar, dont on fête le centenaire cette année à l’occasion du salon du livre, sa place si particulière dans les lettres argentines ?
Sa langue est d’une originalité absolue, au moment où il est publié la première fois à Paris, où il s’installe dans les années 50, on découvre une voix totalement inédite. Il est incroyable. Prenez ses contes, par exemple : chaque histoire est tellement forte, c’est tellement bien construit, il fait appel à des ressorts narratifs inhabituels. On n’avait jamais lu cela. Imaginez : tout d’un coup, une voix qui ne fait pas d’effet, qui n’est pas tape-à-l’œil, vous saisit par sa différence radicale. Pour moi, la jouissance absolue c’est Marelle en 1963, qu’on pouvait lire dans deux sens, en un jeu intellectuel incroyable.
-« Les lettres argentines sont une littérature où se condense le monde » écrit José Manuel Fajardo dans la préface de Cronopios, un livre de Daniel Mordzinski que vous publiez également pour le Salon. Comment comprenez-vous cette assertion ?
Il fait allusion aux multiples origines du peuplement argentin, les Balkans, l’Italie, l’Europe centrale... Un melting pot original, créateur d’une pensée et de talents qui s’enrichissent plus qu’ailleurs en Amérique latine.
-En quoi la dictature a marqué la vie littéraire argentine et comment s’en remet-elle ?
La dictature a indéniablement marqué la littérature argentine. Quand 30 000 personnes disparaissent, des jeunes en majorité, c’est une génération d’intellectuels qui se voit éradiquée. La dictature argentine a été plus violente que celle du Brésil, anticommuniste, semblable à la dictature de Pinochet au Chili. Une vraie chape de plomb l’a suivie : on ne voulait pas parler de ce qui s’est passé. La Loi d’amnistie générale après 1986 a empêché qu’on punisse les tortionnaires. Alors la société a couvert ce qui s’était passé jusqu’à il y a une quinzaine d’années. L’une de nos auteurs, Elsa Osorio, a vécu la dictature. Il y a dans ses textes une structure politique, un substrat psychologique différents de ceux des textes publiés par les jeunes auteurs qui ont trente ans aujourd’hui et abordent la violence d’une époque qu’ils n’ont pas réellement connue.
-La nouvelle est le genre le plus populaire en Argentine, pourquoi ?
Pas seulement en Argentine mais dans toute l’Amérique latine, on trouve des nouvelles extraordinaires : par exemples celles de Fontanarosa, qui était un grand dessinateur humoristique et qui propose dans l’une de mes préférées une façon inédite de partager la littérature classique. Il est très compliqué d’être un bon nouvelliste car ce format est très cruel, il faut savoir terminer.
En France, les nouvelles ne connaissent pas le même engouement : un romancier qui publie un recueil de nouvelles n’en vendra que l’équivalent de 5% de ses ventes de romans.
-Quelle est votre dernière découverte?
Je suis persuadée que Selva Almada va faire une grande carrière. Nous publions Après l’orage, son premier roman. Sa voix est très originale dans un texte faulknerien : une voiture tombe en panne dans un garage au bout d’un désert. Quatre personnages restent ainsi coincés un après-midi pendant un orage. Quand j’ai ouvert le texte la première fois, avant de savoir si j’allais le publier, il m’a suffi de deux pages seulement pour savoir que je tenais entre les mains le manuscrit d’un vrai écrivain. Le livre vient de sortir.
Propos recueillis par Karine Papillaud