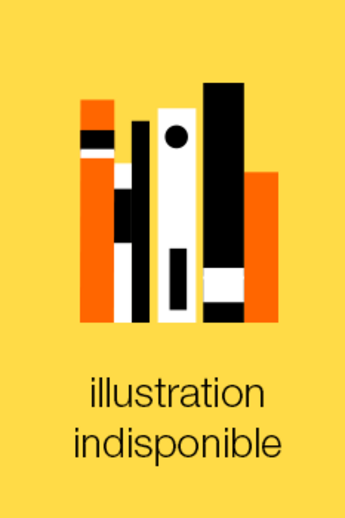Lui qui a toujours joué un rôle de premier plan dans l’histoire de La Bolivie au point de figurer sur les armes du pays, le Cerro Rico menace aujourd’hui de s’effondrer, sapé de l’intérieur par cinq siècles d’exploitation minière. « Mont riche » en espagnol, « celui qui explose » en quechua, on...
Voir plus
Lui qui a toujours joué un rôle de premier plan dans l’histoire de La Bolivie au point de figurer sur les armes du pays, le Cerro Rico menace aujourd’hui de s’effondrer, sapé de l’intérieur par cinq siècles d’exploitation minière. « Mont riche » en espagnol, « celui qui explose » en quechua, on le surnomme aussi « la montagne qui dévore les hommes », tant les mineurs et leur entourage – hommes, femmes et enfants – continuent de lui payer un lourd tribut humain pour des conditions de vie misérables. Après plusieurs années d’investigations et de rencontres, le journaliste espagnol Ander Isaguirre nous livre un reportage choc, assortissant son tableau apocalyptique de la précarité des mineurs boliviens d’un panorama historique et géopolitique qui éclaire les vastes enjeux de l’extraction des matières premières si abondantes dans le pays.
Parmi ses nombreuses rencontres de terrain autour de la ville de Potosi, au pied du Cerro Rico, l’auteur a choisi de centrer son récit sur Alicia, une jeune fille clandestinement employée à la mine depuis l’âge de douze ans, menant avec sa mère et ses frères et sœurs une existence de forçats ne leur assurant même pas de quoi subsister dignement. Son père tué par la silicose quand elle avait huit ans, l’adolescente s’éreinte – au sens propre du terme puisque la pollution des eaux lui a déjà coûté un rein – dans des conditions innommables et terriblement risquées, sans rémunération aucune au prétexte de la dette écrasante que la mine a abusivement attribuée à sa mère veuve. Leurs conditions de vie sont en-dessous de tout : à peine de quoi manger, un campement de fortune sur les pentes empoisonnées du terril où l’on avale et l’on respire une poussière mortifère chargée de métaux lourds, et un travail de bêtes : vers de terre s’infiltrant dans les galeries pour extraire argent et étain à l’ancienne, au simple pic et sans aucune mécanisation ; laborieuses fourmis broyant ensuite au marteau les pierres extraites, pour en tamiser les maigres traces de minerais.
Ils sont aujourd’hui cent vingt milles mineurs en Bolivie, employés dans des coopératives artisanales, à exploiter les gisements du Cerro Rico anarchiquement, sans encadrement, plan ni technologie, et au mépris des plus élémentaires règles de sécurité. A eux tous, qui y gagnent à peine de quoi survivre avec une espérance de vie moyenne inférieure à trente-cinq ans, ils ne représentent que 3 % de la production bolivienne de minerais, le reste étant extrait sans main d’oeuvre par une seule multinationale étrangère de pointe. De fait, depuis que l’exploitation des ressources minières boliviennes a commencé au XVIe siècle, elle n’a jamais profité au pays et à sa population. Les colons espagnols réduisirent les Indiens en esclavage pour mieux faire main basse sur les métaux précieux. Puis, les mines restèrent longtemps sous la coupe de quelques sociétés suffisamment puissantes pour faire et défaire les dictatures au gré de leurs intérêts : elles continuèrent ainsi à exploiter purement et simplement la main d’oeuvre locale, exportant les richesses extraites sans taxation ni retombées économiques pour le pays. Après la révolution de 1952, la gabegie au sein des mines nationalisées provoqua leur ruine et leur fermeture. Une seule fut reprise par un groupe japonais qui a su investir pour la moderniser, les autres furent émiettées en une constellation de coopératives non viables, mais où la population s’empresse de s’employer faute d’alternative.
Aujourd’hui, l’hémorragie se poursuit : la Bolivie n’a que ses ressources naturelles dont l’exploitation continue à lui échapper. Pris à la gorge par la spéculation sur les matières qui a ruiné tant de nations sous-développées, le pays dépend des crédits internationaux et des conditions imposées par ceux-là même qui l’ont étranglé. Et ses habitants, parmi les plus pauvres de toute l’Amérique du Sud avec 94 % d’entre eux incapables de pourvoir aux nécessités de base et même 46 % ne pouvant s’assurer une alimentation de survie, continuent à tomber comme des mouches, écrasés dans les effondrements de galeries, étouffés par la silicose, empoisonnés par l’air et l’eau contaminés, épuisés par la malnutrition et ces conditions de travail bestiales qui les attendent dès l’âge de douze ans.
Malheureusement sans illusion quant à l’impact de son livre dans l’indifférence du monde, Ander Izaguirre aligne implacablement ses constats les plus terribles de la situation des mineurs boliviens, peuplant son évocation de portraits saisis sur le vif, au plus près de la réalité du terrain. Choqué par le sort d’Alicia et des siens, pourtant capables d’une vitalité et d’une résilience confondantes, c’est avec un terrible sentiment d’impuissance désabusée que l’on parcourt le décryptage de l’Histoire et des intérêts politiques, financiers et économiques, qu’en toute objectivité et avec beaucoup de clarté, l’auteur nous propose comme impitoyable genèse de cette situation. Immense coup de coeur.