Merci à toutes et à tous pour cette aventure collective
Passionné(e) de lecture ? Inscrivez-vous
gratuitement ou connectez-vous pour rejoindre la
communauté et bénéficier de toutes les fonctionnalités du site !
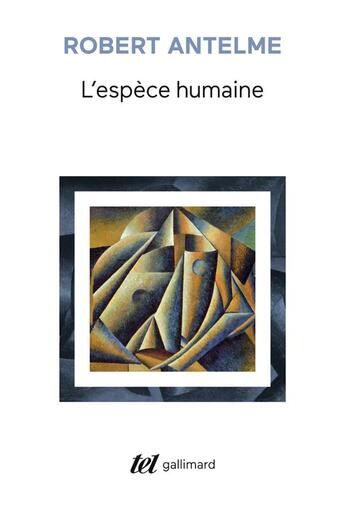
«Quand l'homme en est réduit à l'extrême dénuement du besoin, quand il devient celui qui mange les épluchures, l'on s'aperçoit qu'il est réduit à lui-même, et l'homme se découvre comme celui qui n'a besoin de rien d'autre que le besoin pour, niant ce qui le nie, maintenir le rapport humain dans sa primauté. Il faut ajouter que le besoin alors change, qu'il se radicalise au sens propre, qu'il n'est plus qu'un besoin aride, sans jouissance, sans contenu, qu'il est rapport nu à la vie nue et que le pain que l'on mange répond immédiatement à l'exigence du besoin, de même que le besoin est immédiatement le besoin de vivre. Levinas, dans diverses analyses, a montré que le besoin était toujours en même temps jouissance. Mais ce que nous rencontrons maintenant dans l'expérience d'Antelme qui fut celle de l'homme réduit à l'irréductible, c'est le besoin radical, qui ne me rapporte plus à moi-même, à la satisfaction de moi-même, mais à l'existence humaine pure et simple, vécue comme manque au niveau du besoin. Et sans doute s'agit-il encore d'une sorte d'égoïsme, et même du plus terrible égoïsme, mais d'un égoïsme sans ego, où l'homme, acharné à survivre, attaché d'une manière qu'il faut dire abjecte à vivre et à toujours vivre, porte cet attachement comme l'attachement impersonnel à la vie, et porte ce besoin comme le besoin qui n'est plus le sien propre, mais le besoin vide et neutre en quelque sorte, ainsi virtuellement celui de tous. Vivre, dit-il à peu près, c'est alors tout le sacré. » Maurice Blanchot.
Robert Antelme fut le compagnon de Marguerite Duras. C’est pour surmonter les années de séparation, celles pendant lesquelles elle le savait dans un camp de concentration, qu’elle a écrit La Douleur. De ce long voyage visant à la déshumanisation, Robert Antelme a écrit ce magnifique livre.
De ce document, je garderai la force de l’écriture. Si Robert Antelme fut un prisonnier politique qui n’avait pas publié avant ce livre (et n’a pas publié après, sauf des écrits posthumes) , il a condensé tout son talent dans L’espèce humaine qui me semble être tout ce que Si j’étais un homme de Primo Levi n’est pas (loin de moi l’idée de remettre en cause la qualité de ce document dont le minimaliste ne me convient pas). Quelques semaines après ma lecture de ce document, il me reste des images très fortes : celle du pain qu’on partage en petits morceaux mais qu'on ne peut faire durer longtemps tant la faim tenaille, celle du bruit (oui, j’ai retenu des bruits) de la cuillère dans la gamelle de soupe, cette cuillère qui racle le fond jusqu'au bout, ce bruit qui change à mesure que la gamelle se vide et enfin la main qui se tend dans un train surpeuplé. Je garde aussi et surtout l’importance des mots et de la langue, à différents degrés, à différents moments.
Celui de l’appel, moment qui oblige à sortir de l’anonymat qui, en temps normal, protège :
Et il fallait bien dire oui pour retourner à la nuit, à la pierre de la figure sans nom. Si je n’avais rien dit, on m’aurait cherché, les autres ne seraient pas partis avant qu’on ne m’ait trouvé. On aurait compté, on aurait vu qu’il y en avait un qui n’avait pas dit oui, qui ne voulait pas que lui, ce soit lui.
L’importance de parler la langue de l’oppresseur qui redéfinit le bien et le mal :
Cette utilisation abondante et ostentatoire de la langue allemande- cette langue qui, ici, est celle du bien, leur latin- la même que celle des SS.
Cette langue qui est la seule qui vaille et qu’il est impensable de ne pas comprendre :
Puisqu’il parle, on doit comprendre.
Gilbert qui parle l’allemand s’en sert pour protéger les copains. Et puis, il y a ce mot et cette phrase qui rappellent la rébellion des allemands non nazis, même à l’intérieur des camps, ce « langsam » murmuré pour exhorter les prisonniers à ne pas se tuer à la tâche et ce « Nicht sagen » qui accompagne ce pain donné par une jeune femme qui passe dans le camp.
Mais le langage fait aussi souffrir car il est associé à des sensations perdues :
Le langage est une sorcellerie. La mer, l’eau, le soleil, quand le corps pourrissait, vous faisaient suffoquer. C’était avec ces mots-là comme avec le nom de M… qu’on risquait de ne plus vouloir faire un pas ni se lever.
En temps d’oppression, tout devient l’allié de l’oppresseur : ainsi, le sommeil est important car il n’est que la préparation du travail qu’il faudra fournir le lendemain. Ce qui devient l’allié de l’oppressé, ce sont ces moments, anodins en temps normal, qui permettent de s’échapper quelques instants, comme d’uriner.
Et cette obsession qui reste, la seule qui compte, ne pas laisser l’oppresseur gagner, ne pas leur offrir la mort en cadeau et pour cela, se battre contre le froid, la faim, le travail qui épuise :
La mort est devenue mal absolu, a cessé d’être le débouché possible vers Dieu. […] Ainsi le chrétien substitue ici la créature à Dieu jusqu’au moment où, libre, avec de la chair sur les os, il pourra retrouver sa sujétion.
Il y a aussi ces hommes qui s’éloignent progressivement de l’enveloppe charnelle qu’ont connu les leurs, et qui même au sein du camp ne sont plus reconnus par tous, franchissant alors des étapes qui les mènent vers la mort :
Celui que sa mère avait vu partir était devenu l’un de nous, un inconnu pour elle. Mais à ce moment-là, il y avait encore la possibilité pour un autre double de K…, que nous ne connaissons pas, ne reconnaîtrions pas. Cependant, quelques-uns le reconnaissaient encore.
Des images fortes, il m’en reste de nombreuses autres, un moment père-fils à la fin, la honte qui submerge, mais c’est à vous d’aller les découvrir.
Il n'y a pas encore de discussion sur ce livre
Soyez le premier à en lancer une !

Merci à toutes et à tous pour cette aventure collective

Lara entame un stage en psychiatrie d’addictologie, en vue d’ouvrir ensuite une structure d’accueil pour jeunes en situation d’addiction au numérique...

Un douloureux passage à l'âge adulte, entre sensibilité et horreur...

Blanche vient de perdre son mari, Pierre, son autre elle-même. Un jour, elle rencontre Jules, un vieil homme amoureux des fleurs...