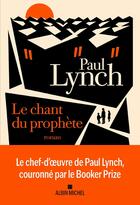Rebelles, un peu (L’Olivier), est le nouveau recueil de nouvelles de Claire Castillon. La nouvelle est un art, l’auteure de Les messieurs (L’Olivier), publié en 2016, y excelle. Attendez-vous à en vivre de toutes les couleurs en ouvrant ce recueil. C’est fou comme l’adolescence va embarquer le moindre des lecteurs, alors qu’il s’en croit protégé par les souvenirs.
Depuis Le Grenier, en 2000, l’un des talents de Claire Castillon est de fabriquer de l’étrange et du singulier, faire jaillir l’émotion et le sens, à partir de ce que nous croyons connaître le mieux , nos topoï, nos familiarités et nos évidences les plus admises et donc rarement pensées. Et cette patte littéraire appliquée à l’adolescence est une bombe émotionnelle qui explose à la figure du lecteur. Rebelles, un peu, ce sont 29 nouvelles qui se consacrent à ce grand moment de transition qu’est l’adolescence : « Peut-être que sans parler directement de l’âge, j’ai beaucoup parlé de la transition, de ce pas à faire, un pied dans l’enfance, et un dans l’âge adulte », explique t-elle dans l’interview exclusive qu’elle a bien voulu donner à Lecteurs.com.
Une langue tout en moire porte la palette des émotions adolescentes. Non pas les affres ou les élans, la littérature « Young adult » et l’arsenal des livres de psy sur la question s’en occupent déjà, mais le soi, l’intériorité dans ses détails qui font exactement la particularité de ce moment de vie. Claire Castillon a su trier l’adolescence des révoltes, détresses, décalages et autres malaises pour en tirer la substance, l’intrinsèque, l’inexplicable qui nous fait dire aux enfants pré-pubères « tu vas en baver, c’est une période difficile », sans qu’on sache vraiment l‘expliquer.
Il y a la fille qui, en parfait syndrome de Stockholm, épouse la folie d’une mère obsédée par sa réussite dans Mets-moi mes baskets, et qui estime, contre l’avis de ses psys et de son entourage que « Ce n’est certainement pas en reniant ma mère que j’irai mieux » et de conclure « je dois lui prouver qu’elle a raison ». Il y a aussi le fils de sociologue dans Je suis un nobod’ qui parle du rapport de force avec le groupe et de sa capacité à s’inverser par les marques et l’adoption des codes. Pour lui, l’intégration scolaire devient une expérimentation intellectuelle, inversant ainsi le rapport de force induit par le règne despotique du « populaire » : « Le foot aussi est une bonne immersion dans la société. Je suis fier quand je vois mon père lire au milieu des gradins. Parfois il pleut et il ne s’en rend même pas compte, pendant que moi je progresse dans la terre humide. Je vais y arriver. Je ne veux plus qu’on me traite de bolos. Je suis devenu l’emblème des nuls au collège et ma transformation sur un an doit être une réussite parfaite ».
On a envie de citer tout ce qu’on lit : Dans J’ai mangé toute la moutarde, une nouvelle sur la consommation de haschisch, l’héroïne s’explique « je ne vis pas pour que ma présence se remarque mais pour que mon absence se ressente ». Derrière les innombrables moments où l’on éclate de rire, il y a toujours une gravité, une mélancolie, un déchirement ou un effroi qui fouaillent le lecteur quand il ne s’y attend pas. Peut être faut-il trouver là l’un des secrets de cette langue moirée de l’auteure, dont le seul et unique réel sujet depuis toujours n’a jamais été autre chose que la littérature.
Karine Papillaud