
Cette année, Blandine Rinkel aura été sur tous les fronts créatifs. Son deuxième roman, Le nom secret des choses, a été publié chez Fayard en août, succédant au déjà très remarqué L’abandon des prétentions (Fayard, 2017). Deux ouvrages qui l’ont propulsée parmi les autrices qui comptent à l’orée des années 2020, en témoigne notre tout récent article à ce sujet.
Blandine Rinkel est également musicienne et chanteuse, une carrière dont on ne dira pas qu’elle la mène « en parallèle », tant les créations de son groupe Catastrophe et son œuvre littéraire semblent s’entrecroiser et se compléter.
En septembre dernier, lors des Correspondances de Manosque où elle était résidente, nous avons eu le plaisir de rencontrer Blandine Rinkel. Cet échange nous a permis d’aborder en profondeur les différents thèmes qui alimentent Le nom secret de choses, mais aussi de faire connaissance avec une artiste sensible qui se plaît à bousculer ses propres peurs et certitudes…
Dans la première partie de votre roman Le nom secret de choses, on sent que l’idée de culture peut être synonyme de souffrance, de frustration. Quel est votre point de vue à ce sujet ?
Sans doute faut-il distinguer le principe de culture (livres, films, etc.) et la culture « légitime ». Ce qu’on appelle la culture générale dans le cadre des concours scolaires, par exemple, n'est pas une culture en vrac, c'est une culture bien précise. Récemment, un article dans Le Monde évoquait l'idée de retirer l’épreuve de culture générale parce qu’elle serait discriminante sociologiquement. Il ne s’agit pas de dire qu’il ne faut pas être cultivé, bien sûr, ça n’aurait pas de sens, mais se rappeler qu’une certaine culture est appelée « générale ».
A titre personnel, ça a pu me frustrer quand j'ai changé de milieu social : j'avais emmagasiné plein de connaissances qui ne me servaient rien, socialement, car ce n'était pas les « bonnes ». Ce n’était pas la culture que les études réclamaient, celle qu'on avait appris dans les familles où on sait ce qu'il faut apprendre. En ce sens oui, c'était frustrant : l’impression d'avoir fait tout un travail qui ne servait à rien. Comme un menuisier qui se retrouverait soudain dans une assemblée de peintres.
On peut en déduire que c’est souvent pour les autres qu’on acquiert et développe sa culture. Pour plaire, pour convaincre ? L’enjeu serait-il de l’aimer pour soi-même ?
C'est exactement ça. Ma narratrice et moi - qui ne sommes pas la même personne mais qui nous rejoignons là-dessus - avons beaucoup lu. J’ai lu spontanément, par amour naissant de la lecture : j’aimais que des inconnus me confient des choses à travers les livres. Il y avait aussi cette solitude que j'éprouvais enfant et qui, soudain, pouvait être éclatée, comme une bulle qu’on percerait.
C'était surtout pour ça que je lisais, mais de manière complètement désordonnée. J'ai lu à la fois Marc Levy et Victor Hugo, dans un même geste, sans juger l'un ni l’autre. Plus tard, en arrivant dans un milieu plus bourgeois, et peut-être aussi en raison des circonstances, de mes études de lettres, j’ai découvert que certaines personnes lisaient avant tout pour impressionner. Donc, oui, c’est très juste, la différence est là, entre la culture pour soi et la culture pour les autres.
Dans le livre, il y a une partie de Trivial Pursuit, un épisode qui est une sorte de traumatisme, mais que j'espère en même temps un peu risible… car aujourd'hui, l'idée que des gens y jouent m’est tout à fait sympathique. Mais j’ai essayé de décrire un moment où on s’expose, alors qu’on ne s’est pas cultivé pour cette situation. Souvent c'est très violent. Comme si notre intimité devenait un outil social. Au départ on ne s'y attend pas ; avec le temps, on s’y fait.
Le livre aborde la question de la légitimité et du jugement qu’on porte sur soi-même, ou qu’on reçoit des autres. On craint de ne pas être légitime, mais est-ce que l’inverse, c’est à dire quelqu’un qui se sentirait à l’aise partout, ne serait pas tout aussi terrifiant ?
Si, effectivement. J'imagine qu'il y a un équilibre à trouver – et que je n'ai pas encore trouvé. Mais c'est aussi assez sain de ne pas se sentir trop légitime. Quoiqu’à l’inverse, la question de la légitimité peut aussi être une mauvaise question, qui empêche d’agir… Disons que les gens qui me touchent, au fond, ce sont ceux qui doutent de leur légitimité à faire des choses — et qui les font malgré tout. Ils essaient de cacher ce manque de légitimité, mais on le sent poindre.
C'est précieux et on en aurait peut-être plus besoin dans les figures très médiatiques, les figures du pouvoir. On a le sentiment que la question ne se pose plus du tout, qu’elle est réglée une bonne fois pour toutes et c'est sans doute un peu inquiétant.
Cela rejoint ce que vous montrez sur scène, avec votre groupe Catastrophe : la peur du ridicule, le besoin de repousser ses limites, non ?
Oui, c’est ce que j’étais en train de me dire. Dans Catastrophe, nous avons tous un problème quant à notre légitimité à faire de la musique ou à parler. Et quand je disais que ce qui me touche chez les gens, c’est qu’ils ne se sentent pas légitimes mais font tout de même les choses, je pensais à eux.
En même temps, y a-t-il un moment où on sera vraiment légitime ? Sans doute pas, donc il faut agir quand même. C’est ce que la narratrice du livre apprend. Elle met du temps à comprendre que beaucoup de gens font semblant d'avoir lu des livres. A un moment, elle dit : « Le retard culturel est un ogre jamais rassasié ». De fait, il ne sera jamais rassasié mais, encore une fois, ce n'est pas un drame singulier : il ne sera rassasié pour personne. Même pour ceux qui semblent avoir le plus confiance en eux. Ce n’est pas si grave.
Vous sentez-vous plus légitime sur scène avec Catastrophe, ou en écrivant ?
En écrivant, car j’ai énormément travaillé. Je lis de manière vorace, depuis l’enfance, ce dont je ne me rendais pas forcément compte avant de changer de vie et de changer de milieu (je ne dis pas ça pour me flatter : cela renvoie à une solitude assez massive.)
Bref, lisant beaucoup, j’ai commencé à travailler l’écriture jeune. J'ai un site confidentiel où je recopie tous les passages des livres qui me marquent, parfois des pages entières, depuis que mes 12 ou 13 ans. Donc j'ai un fichier extrêmement massif (rires) qui est comme une mémoire externe. Avec ça, je me sens relativement légitime, ou en tout cas pas trop illégitime pour parler de livres. A l’inverse, je n'ai aucune technique de chant, je suis autodidacte et sur scène, parfois, j'ai l'impression d’improviser, de brusquer quelque chose. C’est un rapport plus sauvage à l’action, disons.
Ecrire, c’est une quête de justesse. Toute la difficile tâche de l'écriture consiste à parler de ce dont on veut parler avec justesse. Cela prend beaucoup de temps, mais ça ne se voit pas forcément parce qu'on ne voit pas toutes les phrases par lesquelles on est passé.
Sur scène, évidemment, c'est mieux si la justesse est là, mais c'est surtout l'accident, surtout l'énergie qui pour le moment font la différence. Pas la même temporalité. Quant à la question de la justesse sur scène, de la « juste énergie », j’ai l'impression de ne pas être tout à fait au point, d’avoir des choses à travailler… C’est rassurant. La vie est longue et le travail sans fin.
Votre roman aborde en profondeur la question de l'identité, de façon très concrète, avec par exemple un changement de prénom. Construit-on son identité uniquement en réaction aux autres, par imitation ou par rejet ?
D’abord, je pense qu'on ne la construit pas tout à fait volontairement. On est construit. Même quand on croit avoir la main. C’est un bruissement de présence qui forge notre identité, comme notre tempérament. Le livre finit un peu là-dessus, il y a une phrase à la fin qui dit « on se croit seul, mais on a essaimé partout, et on est essaimé par tous ». Même quand on se croit le plus aux commandes, on ne l’est jamais tout à fait. Aujourd'hui, on entend beaucoup « choisissez votre identité, construisez-la », « reprenez votre vie en main »… Je me méfie de cette ultra-positivité qui nous fait croire qu’on est seuls maitres à bord de nous-mêmes. Il y a de l’ombre en chacun de nous, de l’invisible, de l’involontaire, de l’autre. Nous agissons et sommes agis à la fois.
De fait, ma narratrice a au début du roman une identité vague, comme souvent quand on a 18 ans. Elle est « une jeune femme perdue sur le grand échiquier des postures » et, bon, il se trouve qu'elle rencontre une personne plus volontaire, plus affirmée, qui a le goût des métamorphoses et qui lui dit allez, allons-y, prônant la possibilité de choisir qui on veut être, et comment, avec un panache très actuel. La narratrice se laisse embarquer dans ce courant-là, mais elle aurait pu rencontrer quelqu'un qui lui aurait dit au contraire : « l'identité, c’est ce que tu es à l’enfance, et il faut essayer de coller à ça », sans doute serait-elle alors devenue quelqu’un d’autre.
C’est paradoxal, ce jeu entre vos deux personnages : « Sois toi-même, fais comme moi »…
C’est très bien résumé. J'aimerais qu’en terminant le livre, on se dise qu’on n’en a pas du tout fini avec la question de l’identité. La narratrice ne s’est pas trouvée : elle s’est cherchée, a essayé des choses. Tout est en jeu et dépendra des rencontres.
J’aime l’idée d’une identité ouverte, et n’ai pas du tout envie d’en finir avec cette question. Je me méfie - en particulier politiquement - de l’envie d'en finir avec la question de l’identité, de n’en choisir qu’une, une bonne fois pour toute, rejetant celles qui lui sont trop étrangères.
Qui dit identité, dit souvent famille. Dans le roman, le thème de la famille est très présent tout en étant souvent silencieux…
Tout à l'heure, je discutais avec un presque inconnu. On sentait qu'on avait des choses à se dire mais cela n’affleurait pas vraiment : on se parlait, mais en faisant des détours et puis, on s’est mis à parler de nos familles. Et soudain, on a compris pourquoi on s’entendait à demi-mot depuis le début de la conversation. Quand on a accès à l'histoire familiale des gens, on a souvent les pièces manquantes du puzzle de leur personnalité. C’est cohérent que la littérature s’intéresse tant aux histoires de familles : c'est si souvent ce qu'on ne dit pas, ce qu'on ne sait pas et ce qu'on ne voit pas chez les autres.
Il y a un passage au début du livre, où la narratrice explique qu’elle apprend l'art de fréquenter la terrasse, l'art de fumer en terrasse avec ses nouveaux camarades parisiens. On y parle vraiment de tout, de sexe avec une grande crudité, des actualités politiques, culturelles, etc. — mais jamais de l'intime, jamais de la famille. C’est quelque chose qui n’affleure pas, ou alors uniquement sur le mode du rire et de la blague. Et d’emblée, cela l’inquiète. Mais elle imite les autres, et passe aussi sous silence sa famille.
Par peur du jugement ?
Je ne sais pas exactement. Peut-être l’impression que ça n'entre pas dans le registre du « cool ». Ou alors par crainte qu’on en fasse un motif réducteur — celui de la famille de province.
Le père de la narratrice est un peu comme le fantôme du livre. A mes yeux, c'est un fantôme important - qui n’a rien à voir avec mon père soit dit en passant. C’est le fantôme principal, disons. Celui qui est au premier plan du livre. La narratrice s'arrange un peu pour l'oublier, parce qu’il n’est pas compatible avec la vie qu’elle découvre. Il y a une douleur dans cette incompatibilité. Finalement, elle est obligée de refouler le père, la famille, pour supporter ce qu'elle devient.
Il y a une scène à l'hôpital, où la narratrice s’interroge sur la confiance. Elle est face à ce petit formulaire, où vous devez préciser qui est votre « personne de confiance ». La question la plus impudique de l'administration française ! Et elle songe à l’ironie qu’il y a, à avoir rencontré tant de visages dans l’année, et à pourtant, évidemment, inscrire le prénom de son père dans la case. Un prénom auquel elle n'a pas pensé pendant des mois. C’est une évidence désarmante — car elle s’était arrangée pour l’omettre. C’est dur de revenir à ses parents parfois, cela ne va pas sans culpabilité.
Et puis quand on quitte ses parents, pour peu qu’ils nous aient aimé, on se demande si on retrouvera quelqu'un dont l'amour peut être aussi inconditionnel que celui dont on a joui dans l’enfance. Comme Romain Gary, expliquant que c’est un malheur d’être aimé si tôt et si fort par une femme, sa mère, parce qu'après on ne supporte plus de constater que ça n'arrive plus.
Dernière question, concernant Paris, présente dans le livre comme un personnage ou une créature. Qu’avez-vous essayé d’en dégager dans Le nom secret des choses ? Est-elle effrayante, merveilleuse ?
Les deux à la fois. J’ai essayé - je ne sais pas si j’y arrive - de décrire Paris telle qu'elle apparaît à une jeune fille qui vient de loin. A la fois inhibante et grisante. Mon intention est de décrire, et non de porter des jugements pour accuser ou défendre. Même si j’imagine que malgré moi, je le fais.
Ce qui m’intéressait : la dualité de la ville. J'ai voulu par exemple décrire les cris non-identifiés qu'on entend dans la ville, la nuit. Un jour sur deux, il y a un moment où j'entends un hurlement, un râle terrible, inhumain et trop humain. C’est terrifiant, et pourtant on s’y fait : à quel moment s’y habitue-t-on ? Dans d’autres villes, ou villages, en entendant cela, on sortirait, on allumerait les lumières, se demandant ce qui se passe. A Paris, vient un moment - peut-être celui où on devient parisien - où on ne les remarque même plus. On entend un cri monstrueux et on ne se dit plus rien : ça fait partie du paysage.
Décrire cela, c’était une porte d’entrée pour décrire l’inconscient de la capitale. Le jour, c’est la « ville lumière », bigarrée, mixte, étonnante, mais la nuit, on devine l’espèce de « ville noirceur », son envers disons. Je voulais décrire ces aspects contradictoires, doubles : c’est, au fond, un livre sur le double. Comme j’écris de manière très désordonnée, il m’a fallu du temps pour comprendre le sujet du livre. A un moment, ce mot « double » s’est imposé, je l’ai écrit en majuscules sur une feuille A4 ; c’est dérisoire, mais c’était ça : le double en soi, le double chez les autres, l’amitié qui rend double, la ville double… Tout est double, multiple et contradictoire — eh bien ? Vivons avec nos contradictions.
Propos recueillis par Nicolas Zwirn














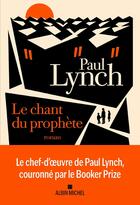


Voilà ! J'ai lu le livre et donc relu l'interview qui m'a bien éclairé sur plusieurs points d'un texte fourmillant de sous-entendus, de côtés obscurs et que je comprends mieux maintenant. Merci encore, Nicolas !
Ah oui, un très bel entretien qui reflète vraiment bien l'esprit du bouquin. J'ai beaucoup apprécié de le découvrir après avoir lu le livre. Cordialement.
Excellent entretien, Nicolas ! Tu m'as donné envie de lire son livre. Ghislaine l'a déjà lu et je vais bientôt m'y plonger et je pense qu'alors je relirai ton article plein d'enseignements. Merci !
Bonjour, merci pour cette chronique. Ecrivaine musicienne chanteuse… quel talent!