Des idées de lecture pour ce début d'année !
Passionné(e) de lecture ? Inscrivez-vous
gratuitement ou connectez-vous pour rejoindre la
communauté et bénéficier de toutes les fonctionnalités du site !
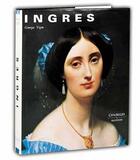
Qui ne connaît Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867) ? Du moins de nom (à cause de son hobby préféré, le violon) ou alors pour l’une ou l’autre œuvre : « La Grande Odalisque » (1819, avec ses vertèbres surnuméraires), « la Baigneuse de Valpinçon » (1808, avec des jambes trop frêles pour supporter son corps), et, bien entendu, « le Bain turc » (1852-1862, chant du cygne du maître, vu par le trou de la serrure, d’où la forme de tondo). Mais bien d’autres œuvres font partie de l’inconscient collectif des Français car présentes dans les manuels ou les dictionnaires : « la Source » (1856), « Œdipe explique l’énigme du Sphinx » (1827 ; en réalité, face au héros mythologique, une sphinge), « Napoléon Ier sur le trône impérial » (1806), voire « l’Apothéose d’Homère » (1827) ou « le Songe d’Ossian » (1812-1813). Il suffit de vous dire : peinture française du début XIX° siècle, et vous me citez Ingres aux côtés d’Eugène Delacroix, son contemporain.
Cette imposante monographie, aux luxueuses reproductions, cumule toutes les qualités d’un ouvrage incontournable : le texte, l’iconographie, la mise en page, les informations scientifiques, tout plaide en sa faveur. Pourtant, ce n’est pas un catalogue raisonné mais, à côté des œuvres citées ci-dessus, nous avons droit aux différentes versions (autographes ou par l’atelier du peintre) d’un même tableau mais également des dessins, des détails des portraits (rien que pour le taffetas des robes, la lumière des pierres précieuses, ou la légèreté d’une plume au cœur d’une coiffure, je tire mon chapeau au savoir-faire, à la technique talentueuse). Mais également des œuvres bien moins connues du grand public « Portrait de Caroline Murat », « Portrait de la Princesse de Broglie » ou la fresque du Château de Dampierre.
Les auteurs ont toujours tendance, pour parler d’Ingres, à séparer ses dessins de ses peintures. Pour Ingres, le dessin était « la probité de l’art ». A un tel point qu’il répétait, étudiait, changeait, corrigeait, réinterprétait ses esquisses, jusqu’à dénaturer l’œuvre finale en l’enfermant dans un statisme et un mutisme d’une froideur toute antique, ce que Georges Vigne, ancien conservateur du Musée Ingres à Montauban, ne dissimule pas. Aujourd’hui, je dirais que les dessins m’intriguent (et m’émeuvent bien plus que certains de ses portraits).
Ingres était un admirateur fervent de Raphaël, ce qui semble paradoxal pour un peintre néoclassique. Il a traversé les époques et les régimes politiques : né sous Louis XVI, il connaît successivement la Convention, le Directoire, le Consulat, l’Empire, la Restauration, la Monarchie de Juillet et le Second Empire. Lui, l’élève de Jacques-Louis David, est resté fidèle au classicisme, imperturbable, sans subir l’influence ni du Romantisme, ni du Réalisme, ni des prémices de l’Impressionnisme.
Mais ce qui fait l’intérêt de tous ces corps féminins (parfois masculins, mais ils sont plus rares), ce sont les « erreurs » anatomiques (ce goitre récurrent, la dysmorphie d’un membre par rapport au reste du corps) qui donnent une cohérence esthétique au tableau, tout en refusant de se plier à la copie de la réalité. Il y a donc bien un style ingresque, ce qu’on appelle actuellement un concept, si ce n’est une conception du corps. Conception qui fascinera aussi bien Picasso, Matisse, Martial Raysse que Jiri Kolar.
Il n'y a pas encore de discussion sur cet auteur
Soyez le premier à en lancer une !

Des idées de lecture pour ce début d'année !

Si certaines sont impressionnantes et effrayantes, d'autres sont drôles et rassurantes !

A gagner : la BD jeunesse adaptée du classique de Mary Shelley !

Caraïbes, 1492. "Ce sont ceux qui ont posé le pied sur ces terres qui ont amené la barbarie, la torture, la cruauté, la destruction des lieux, la mort..."