
La nouvelle édition du Prix Orange du Livre présidée par Jean-Christophe Rufin confirme plus que jamais l’audace de ce prix littéraire et son ambition de distinguer des romans très littéraires et accessibles au grand public.
Matador yankee de Jean-Baptiste Maudet (ed. Le Passage) raconte le road trip d’un homme moitié cow-boy, moitié torero, coincé dans une géographie qui ne sait pas très bien distinguer le Mexique de l’Amérique et entouré de personnages attachants en quête de liens. Un roman, et plus impressionnant encore un premier roman, fortement marqué par ses ambiances et une vraie réflexion sur la frontière et les marges culturelles.
Jean-Baptiste Maudet a accepté de raconter les dessous de son roman. Entrons dans l’univers d’un bel écrivain en devenir.
- Vous venez de recevoir le Prix Orange du Livre pour un roman, Matador yankee (ed. Le Passage) qui marie la culture de la tauromachie avec celle… du rodéo. D’où vous est venue l’idée de cette histoire ?
Je suis géographe et je travaille sur la tauromachie depuis 15 ans. J’ai prolongé vers le monde du rodéo pour m’interroger plus largement sur les relations entre humains, bovins et chevaux. Le rodéo et la tauromachie sont les deux traditions qui mettent en scène un affrontement réel entre un humain et un animal. Cela fait un sérieux point commun.
J’ai travaillé sur la question de ce cousinage avec l’anthropologue Frédéric Saumade pendant quatre ans, nous avons publié un livre Cowboys, clowns et toreros en 2014 ainsi qu’un documentaire. Quelques années ont passé et je pensais souvent aux gens qu’on a rencontrés sur cette frontière entre le Mexique et les Etats-Unis, ces gens qui ne sont en fait nulle part à leur place ou partout chez eux, Indiens, Mexicains, Américains. Dans ce contexte des fêtes et des spectacles, ils participent aux mêmes ambiances et aux mêmes cultures et sont difficilement assignables à des identités simplistes. J’ai eu envie de parler d’eux dans un grand roman d’aventures autour de la figure hybride du cowboy torero.
- Pourquoi avez-vous choisi la fiction quand l’université vous fournit un matériau scientifique pour prolonger ce travail ?
J’en avais assez d’écrire des articles et des livres académiques sur ces questions-là. Je voulais faire un vrai pas de côté par rapport à mon métier pour creuser le sujet de la complexité du lien entre culture et tradition. C’est une complexité difficile à donner à voir dans les travaux universitaires qui parfois écrase les individus, leur singularité. Il y manque les rencontres, il y manque le fait que nous sommes tous à la fois des personnes et des personnages. Dans ce roman, j’ai pris soin à ce qu’il n’y ait rien de pédagogique. Le but n’était pas de faire un roman géographique ou historique, mais bien un roman d’aventures avec l’objectif de mêler fiction et réalité et d’associer culture populaire et culture savante.
- L’histoire ne semble ancrée dans aucune époque historique précise. Est-ce délibéré ?
Oui, complètement. J’ai gommé les références aux époques et aux âges, toute forme de datation trop évidente qui permettrait de savoir quel jour on est. J’ai voulu faire disparaître ces détails pour n’opposer aucune entrave à l’imaginaire du lecteur, qu’il puisse embrasser les personnages, entrer dans l’univers de la tauromachie et du rodéo, et que chaque monde puisse se déployer dans la tête de chacun.
- Souhaitiez-vous faire émerger des archétypes ?
Plutôt des contre-archétypes, mais oui, il y a cette volonté de ne pas ancrer les scènes dans des moments trop précis. Une date, paradoxalement, peut sortir le lecteur de la fiction, car ce dernier y rattache tout un vécu et un imaginaire personnel qui créent des dissonances et perturbent son accès au texte. Le film Butch Cassidy et le Kid, de George Roy Hill, sorti en 1969, est un des rares repères daté autour duquel s’organise la narration. J’ai volontairement évité les marques ou les produits reconnaissables, la présence de téléphones portables, d’objets de la culture matérielle qui permettent d’entrer dans une historicité évidente.
Je suis allé jusqu’à gommer les descriptions des personnages. J’avoue, c’était un pari, et j’ai craint, tout le temps de l’écriture, qu’ils manquent d’épaisseur. Mais je n’avais pas envie de fixer des âges, ils sont juste définis par quelques touches, des repères relatifs les uns par rapport aux autres. Tout cela fait partie d’un même parti pris : ne pas jouer sur les effets de réel.

- Dans ce road trip, vos personnages semblent avant tout des trajectoires humaines qui se cherchent un sens…
La plupart des personnages ont traversé des épisodes difficiles, ils cherchent à se refaire, ou sont un peu perdus au moment où l’histoire les cueille, sur une unité de temps assez courte. Harper le torero a sa carrière derrière lui, il n’a pas réalisé ses rêves, se pose des questions. Il trouve absurde d’être encore torero aux Etats-Unis au début du XXIe siècle et aimerait passer à autre chose. Miguel est un peu médecin, avocat, garde du corps, le parfait second couteau, mais il a finalement une trajectoire plus lumineuse, rencontre l’amour, s’enrichit, part en Espagne. Je voulais que les itinéraires des personnages ne soient pas donnés d’avance, tout en respectant les codes du roman d’aventures. Je suis très admiratif du cinéma à la fois léger et profond qui parvient à associer culture savante et populaire.
- Vous êtes universitaire et chercheur, vous écrivez beaucoup, qu’est ce qui vous a séduit dans l’idée d’entrer dans l’écriture romanesque ?
L’écriture existe chez moi depuis longtemps. J’ai commencé mes études en faculté de lettres, et j’ai rapidement vu que cela ne me conduisait nulle part, avant de bifurquer vers la géographie. J’ai toujours été intéressé par la manière de parler du monde qui nous entoure, faire rencontrer l’imaginaire et le réel dans la fiction. C’est un grand sujet qui m’occupe presque quotidiennement.
Et puis j’ai eu envie de me lancer. J’ai d’abord écrit beaucoup de la poésie. La plupart des chapitres de Matador Yankee tiennent par deux phrases, une scène ou une image qui m’intéressent et autour desquelles je construis le chapitre. Le moteur de mon écriture romanesque est là. Au fond, je crois que je n’aime la poésie que lorsqu’elle est immergée dans l’écriture romanesque, prête à s’autodétruire.
- Un premier roman et un premier prix littéraire, le Prix Orange du Livre, présidé par Jean-Christophe Rufin et départagé par les internautes. On imagine que vous avez dû être heureux. Comment mesuriez-vous vos chances ? Aviez-vous lu les autres romans en lice ?
Non je n’ai pas lu les autres romans, mais j’ai celui de Franck Bouysse avec une dédicace très sympa et je compte bien le lire cet été.
Ce que je sais, notamment grâce aux lectures des extraits par Marie-Christine Barrault et François Marthouret auxquelles j’ai pu assister, c’est que nos propositions sont très différentes. Je tenais aussi à le dire le jour de la remise du prix, et dans le fond, il est bien évidement curieux de devoir les départager. Ce n’est peut-être pas significatif et en aucun cas un jugement de valeur, mais ces livres ont malgré tout en commun une certaine audace narrative et formelle dans la façon raconter une histoire et une mise à distance avec l’autofiction. Mes chances, je ne les mesurais pas vraiment, je voyais simplement qu’il y avait parmi les finalistes soit des auteurs confirmés soit des grosses maisons d’édition. C’est peut-être aussi ce que je me suis raconté pour ne pas trop y croire.
La semaine avant la remise du prix, j’étais à Montréal, je suis rentré dans une librairie et les livres finalistes y étaient tous, sauf le mien. Je n’en ai pas fait toute une affaire, un premier roman, avec un titre pareil ! Et je me suis dit que si j’avais ce prix, ça aiderait ce livre peut-être un peu plus que celui des autres. Encore une fois, on se raconte des histoires parce qu’au contraire l’effet premier roman a peut-être joué en ma faveur, et contribué à une forme de bienveillance. Je ne sais pas. Ce qui est sûr c’est que je suis fier d’avoir reçu ce prix, fier aussi que ce prix fasse appel à des auteurs, des libraires et des lecteurs, ça témoigne à mes yeux d’une ouverture.
- Recevoir un prix de lecteurs alors qu’on a publié son premier roman, quelle sorte de pression cela représente-t-il pour la suite ?
J’avais fini d’écrire le deuxième roman bien avant de recevoir le prix, mais j’ai décidé d’attendre encore un peu pour remettre le manuscrit !
Sans ce prix, j’aurais peut-être donné la dernière version du texte plus spontanément à mon éditeur, j’ai envie qu’il soit à la hauteur de l’espérance que ce prix des lecteurs donne à la suite de mon premier roman. Tout le monde me met la pression sur le deuxième roman en me disant que c’est le plus difficile ou qu’il ne devrait y avoir que des premiers et des troisièmes ! Je ne bénéficierai pas de la bienveillance qu’on a accordée au premier. Le gros avantage c’est que la première mouture était finie avant même que le premier roman ne sorte. Je n’ai donc, pour l’instant, rien écrit dans l’ombre des commentaires, des critiques, des photos de chats sur les réseaux sociaux, des listes de prix, etc.
Dans un sens, cela donne beaucoup de liberté. Il en sera question dans le prochain livre qui sera encore un roman d’aventure, en Sibérie cette fois.
















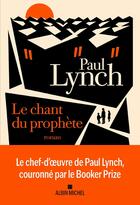


Tres interessant j aimerais bien le decouvrir un de plus dans ma bibliothèque et pour l ete se serait super
Jean Baptiste Maudet ? Un grand bonhomme qui n'a pas fini de nous surprendre !
Et bien, que voilà un bel auteur !! J'ai retenu le livre à la bib