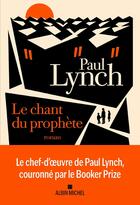![[Interview] Qui êtes-vous, Charles Robinson, sinon un des personnages discrets de votre roman ?](https://static1.lecteurs.com/files/articles/2_charles2.jpeg?1?1742995140)
Quand Charles Robinson répond à nos questions... Une pépite à découvrir !
- Fabrication de la guerre civile est votre troisième roman. Il suit la publication en 2011 de Dans les cités, et l’on y retrouve des personnages. Quelle réflexion aviez-vous envie de prolonger ou d’émettre après ce premier texte sur cette cité des Pigeonniers ?
Dès le départ, le projet a été de créer un vaste univers. Écrire un peuple, donc des voix, des présences, des histoires, des anecdotes, parfois de très petits détails. Un coup de fil à 7 heures du matin prévient un ouvrier qu’il ne doit pas venir sur le chantier ce jour-là, parce que son employeur craint une visite de l’inspection du travail. Un père de famille sort sa petite Darling au jardin d’enfants. Il est question de tartes aux pommes, de choisir un papier-peint. Un crépitement d’humanité.
Mais l’appartement à côté est occupé par un des guetteurs de Budda. Et, là, on commence à basculer dans les aventures, même si être guetteur consiste principalement à se les peler dans une cage d’escalier sans lumière.
J’avais envie d’offrir aux lecteurs une familiarité avec l’univers pluriel des Cités : une fréquentation dans la durée. J’avais donc besoin d’espace, de temps. Les deux volumes se sont imposés. Il faut ajouter une pièce radiophonique, adaptée de Dans les Cités, et les nombreuses lectures live, qui continuent à faire vivre les personnages et l’écriture.
Dans les Cités et Fabrication de la guerre civile sont deux livres autonomes. Et ils sont teintés chacun d’une tonalité particulière. Dans les Cités est imbibé d’adolescence, même pour les adultes : c’est un livre travaillé par cet âge d’impuissance acnéique, ses empêchements, avec quelque chose d’un peu renfrogné. Fabrication de la guerre civile reprend au même endroit, mais à l’âge adulte : le texte se fait plus sec, plus rude, plus direct. Il y a quelque chose de brûlé. Les personnages jouent leur peau.
En travaillant sur deux livres, j’ouvre la possibilité de travailler deux états différents : c’est intéressant de voir vieillir un monde fictionnel.
- Doit-on attendre un troisième roman sur le sujet, construisez-vous un triptyque ?
Je travaille sur d’autres formes que le roman. Il y a pour les deux livres plus d’une centaine de personnages, je suis en train d’imaginer un index, au format numérique, avec des textes inédits pour chacun, mais aussi des sons, des photographies, des vidéos. Là encore : faire monde. Prolonger la joie enfantine du créateur qui fait émerger des présences, des histoires, des vies, des accents. Tenter de crépiter encore.
Je travaille aussi sur une forme de lecture qui implique musiciens et comédiens. Il y aura un texte inédit et une forme finale assez punchy. C’est quelque chose que nous avons amorcé lors de la dernière Nuit Blanche, à Paris, sous le nom de Râga du soir, et que l’on peut découvrir ici : dans les cités. Râga nocturne
Mais a priori, il n’y aura pas de troisième roman.
- Parlons de la langue du livre, ou plutôt des langues : chaque locuteur a son idiome, vous avez recouru à des graphies différentes dans le texte qui, de fait, apparaît très hétérogène dans sa forme. Quelle impression, ambition poursuiviez-vous ?
La langue manifeste ce peuple dont je parlais précédemment. Un peuple, somme d’individus singuliers, est un vaste composite de voix, de pensées, d’accents, et aussi d’usages de la langue. On peut faire de la langue un usage très combatif, affirmer son identité, draguer, se protéger, etc. La langue dessine le relief de ce peuple. J’essaye de ne pas écrire en « Robinson » puisque ce n’est pas moi qu’il faut manifester, mais de trouver au fur et à mesure la forme la plus juste pour un lieu, un moment du livre ou un personnage. C’est un travail de chef-op, d’ingé-son, d’éclairagiste, mené dans la langue.
Un des grands bonheurs du romancier est l’écoute attentive et permanente. La détection des trésors partout où quelqu’un ou quelque chose parle. Puis je démonte ces trésors, j’essaie de comprendre comment ils fonctionnent, pour réinjecter leurs mécanismes dans le cours de l’écriture. C’est un travail de collecte et de réinvention.
Le roman apporte aussi un souffle à cet ensemble hétérogène, pour que le livre ne devienne pas un catalogue de fragments ou de morceaux de bravoure. Ce souffle, ou cette sorte particulière de vitesse, faite de drame, de situations sociales, de noirceur, de politique, traverse ces trésors et les embarque comme une vaste lame de fond.
Le roman, ça sert à faire tanguer des trésors.
- Vous croisez des parcours humains différents, tous plus ou moins désabusés, qui sont plutôt des destins que des individus : chacun semble suivre une trajectoire déjà tracée. C’est une vision assez pessimiste de la réalité contemporaine, ou… réaliste ?
Je ne sais pas si l’observation scrupuleuse de notre monde doit rendre optimiste…
Je parlais de vies, de détails, d’anecdotes : donc de ce qui concourt à créer la Cité des Pigeonniers et le Quartier des Oiseaux comme des lieux vivants, des presque-réels.
Mais le livre est aussi travaillé par un axe mythologique. Il y a en effet beaucoup de destins, de héros et d’anti-héros, de sacrifiés, de fatalité. Il y a du vaudou, des monstres, des affrontements.
Nous avons toujours inventé des mythologies pour enchanter et penser nos douleurs, nos contradictions, nos crises. Cette forge mythologique nous sauve de la plate laideur du réel. Les Grecs, Shakespeare… Il s’agit d’échapper à la trivialité de l’anecdote pour nous inscrire dans quelque chose de plus grand, de plus vaste, pour nous raccrocher aussi à l’histoire de l’humanité et du monde. Pour nous chanter, dans les sanglots et les grands rires.
Il y a un choix politique dans le fait de rapprocher les Cités de nos mythologies. Ce qui est vécu dans ces lieux, ces intensités humaines, méritent nos espaces de mythologie.
Un écrivain a peu de pouvoir, peu d’impact politique concret. Mais il peut participer à cette inscription. À donner de l’ampleur, et donc d’une certaine façon rendre justice à ce qui est vécu.
- Se dégage du texte, non pas une révolte sous-jacente, mais quelque chose comme la sécession d’une communauté humaine au sein de la République. Est-ce un point de vue politique de votre part ou plus redoutablement ethnologique ?
Nous vivons une époque politique complexe, secouée par des vents de colère qui partent de loin, avec des enchevêtrements de crises, si enracinées que ce mot de crise perd beaucoup de son sens. Est-ce qu’il y a, du coup, quelque chose de particulier à notre époque ? Je vois au moins un aspect très singulier.
Les révoltes classiques affrontent des systèmes injustes, pour briser des exclusions. Les écartés exigent et se forcent une place dans la société. Ils bataillent pour accéder pleinement au corps social.
Ce qui me semble particulier aux moments que nous vivons, c’est l’émergence de révoltes qui prennent acte de ce que les sociétés sont injustes, et qu’il ne faut donc plus chercher à en faire partie. Ce sont des mouvements qui prennent la tangente, qui disent : vous ne pouvez rien pour nous. Saï, un des personnages, le dit explicitement dans le livre : « Retirez les allocs, mais alors soyez cohérents, retirez aussi les flics, et chacun chez soi. Nous allons vous fermer l’accès aux Cités, on vous réinvitera plus tard, quand nos enfants auront mis autre chose sur pied ».
Les révoltes classiques contestent la société en place, mais veulent y substituer une société de même nature, avec des régimes de partages différents. Nous sommes dans un temps où il ne s’agit plus de faire société commune, mais de séparations : chacun, chaque groupe, sur son bout de banquise, et autant de dérives.
- Mais au fait, qui êtes-vous, Charles Robinson, sinon un des personnages discrets du roman ?
Jolie formule, je prends : je suis un discret du roman. J’habite là, je pense là un moment, en compagnie de personnages qui sont des voisins, des proches : des irremplaçables.
Comme tous les discrets, je finis nomade, je lève le camp pour voir ailleurs : une autre configuration d’histoires, d’imaginaires, de lieux et d’êtres, et y planter à nouveau temporairement ma tente. Je cherche mon style à chaque fois, comme on cherche sa bonne étoile.
Peut-être est-ce de voyager discret et très léger qui donne au romancier son pouvoir de faire attention, quand il se pose quelque part.
Site web : Charles Robinson
Propos recueillis par Karine Papillaud
Retrouvez également ce qu'on dit de "Fabrication de la guerre civile" dans notre revue de presse #1
La chronique de "Fabrication de la guerre civile" ici