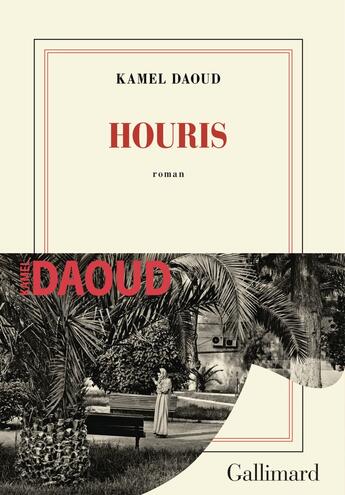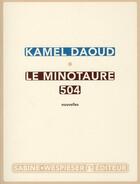Elle s’appelle Aube, habite le quartier Miramar, à Oran, en Algérie, et parle à l’enfant qu’elle porte, sa Houri, comme elle l’appelle, car elle est sûre d’être enceinte d’une fille. Aube, son nom dans la langue intérieure, Fajr dans la langue extérieure, a 26 ans et elle est muette.
Pourquoi...
Voir plus
Elle s’appelle Aube, habite le quartier Miramar, à Oran, en Algérie, et parle à l’enfant qu’elle porte, sa Houri, comme elle l’appelle, car elle est sûre d’être enceinte d’une fille. Aube, son nom dans la langue intérieure, Fajr dans la langue extérieure, a 26 ans et elle est muette.
Pourquoi parler de langue intérieure et de langue extérieure ? Aube l’explique et fait partager ses souffrances. Au cours de cette guerre civile des années 1990, elle a été égorgée, ses cordes vocales ont été sectionnées mais elle a survécu par miracle alors que sa sœur de 8 ans se sacrifiait pour attirer l’attention des assassins sur elle. Depuis, Aube respire avec une canule et parle souvent de sourire lorsqu’elle évoque sa cicatrice.
Dans Houris, tout le récit de Kamel Daoud est articulé autour de ce drame, un des nombreux épisodes tragiques d’une guerre civile presque complètement effacée par les autorités algériennes. La seule guerre reconnue et célébrée et celle d’indépendance mettant fin à la présence française, en 1962.
D’emblée, je suis épaté, captivé par l’écriture émouvante, précise, directe, franche, terriblement réaliste de Kamel Daoud que j’avais découvert avec Meursault, contre-enquête. Dans ce roman, il ne néglige pas la poésie et sait parfaitement décrire la vie de ce pays si proche et si différent du nôtre.
Kamel Daoud conte des épisodes dramatiques avec infiniment de tact et de douceur mais se montre sans pitié pour ceux qui jouent la comédie de l’intégrisme religieux. Comme il nous l’a affirmé lors des récentes Correspondances de Manosque, tout ce que l’imam martèle pour endoctriner ses fidèles et marginaliser les femmes au plus haut point, il l’a entendu. Ce passage, lorsque Aube parle de son salon de coiffure est particulièrement choquant, révoltant et émouvant à la fois, comme l’épisode du gynécologue devenu islamiste.
Ainsi, Aube est la preuve vivante que cette guerre civile qui a duré dix ans et a fait au moins 200 000 morts, a bien existé. Plusieurs épisodes dramatiques sont exposés avec la date et le nombre de victimes comme à Bentalba, quartier d’Alger, où dans la nuit du 22 septembre 1997, 400 personnes ont été massacrées et égorgées.
Dans le village dont Aube est originaire, Had Chekala, sur la première colline de la chaîne des Ouarsenis, le 31 décembre 1999, en une nuit, 1001 morts ont été dénombrés avant que la guerre cesse. Cette nuit-là, Aube affirme qu’elle est née une seconde fois.
Dans la seconde partie, la rencontre avec Aïssa, ce libraire qui sillonne le pays pour vendre des livres de cuisine et des ouvrages religieux, le roman change d’envergure et beaucoup d’interrogations sont levées. Aïssa démontre tout le non-sens d’une guerre civile et la nécessité de briser l’oubli ce que fait Kamel Daoud dans Houris, le roman le plus fort de cette rentrée littéraire.
Au passage, tout ce que pense Aube, est noté par l’auteur entre parenthèses comme ce qu’elle confie à sa Houri, dans son ventre, cette enfant qu’elle refuse de mettre au monde. Tout cela est bien démontré comme le sort scandaleux réservé aux femmes des terroristes qui s’en sont tirés en affirmant qu’ils n’étaient que « cuisiniers » !
Une écriture parfaite, un récit plein de surprises côtoyant parfois l’imaginaire et même la poésie, Houris est un roman qui m’a souvent bouleversé et profondément marqué. Kamel Daoud, pour l’écrire, a dû prendre ses distances et sa liberté face au déni et à l’oubli.
Chronique illustrée à retrouver ici : https://notre-jardin-des-livres.over-blog.com/2024/10/kamel-daoud-houris.html