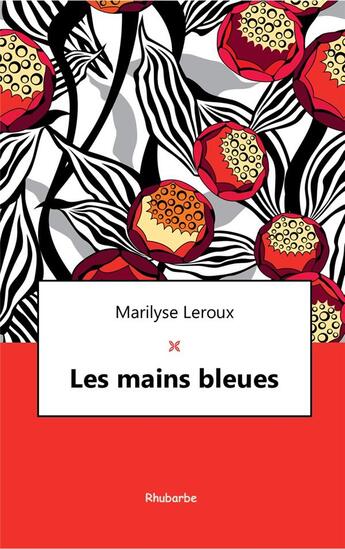Le bleu peut-être une couleur douce et rassurante comme celle de l’azur ou de la mer, mais aussi la couleur des douleurs, des bleus à l’âme.
« L’air qui bleuit comme s’il pourrissait. »
Au bord du fleuve, une jeune femme se souvient des siens, de son enfance. Elle se souvient des morts et...
Voir plus
Le bleu peut-être une couleur douce et rassurante comme celle de l’azur ou de la mer, mais aussi la couleur des douleurs, des bleus à l’âme.
« L’air qui bleuit comme s’il pourrissait. »
Au bord du fleuve, une jeune femme se souvient des siens, de son enfance. Elle se souvient des morts et c’est une souffrance.
« Le chagrin a pris ma peau »
Le temps s’écoule avec l’eau du fleuve qui « continue d’ignorer [son] nom ». La mort est très présente, « ce n’est pas la pluie mais la terre qui dégoute ses morts » à se demander si la narratrice est bien vivante. Mais elle l’affirme « je ne suis pas morte puisque mes yeux voient ».
Difficile de raconter sa propre souffrance « …mes mots ont la langue coupée. »
La mère et l’amour qu’elle offrait reviennent comme un refrain dans le chant des souvenirs et celui de sa fille la dérobe à l’oubli.
« Je me souviens du chant de ma mère qui comptait les étoiles au-dessus de ma tête. »
On ne peut être que troublé et subjugué par le portrait lumineux de la mère qui « avait des mains bleues à brasser le ciel » et une vision allégorique du monde, la mère qui aime sa fille et refuse qu’elle soit excisée avec « l’épine qui coud le corps des femmes. »
Derrière le portrait de la mère sourdent les échos d’une enfance heureuse. Mais la violence surgit, celle du viol, de la mort et de l’exil. En filigrane se lit le drame de toute femme « que vaut la vie d’une fille ? »
Le malheur s’abat « Jour noir, nuit blanche, les murs sont tombés sur nos têtes. Nos têtes ont perdu leurs yeux. »
La mère disparue, ce sont les origines même de l’existence qui disparaissent.
« Ma mère est morte. Je suis orpheline de sa vie, orpheline du regard de nos bêtes, orpheline de la terre sous mes doigts, des noms qu’elle donnait à tout ce que je voyais. »
Dans l’ombre de la mère, ce sont les femmes, toutes les femmes qui sont évoquées
« Femmes, je me souviens de vous, de vos mains habiles à semer, ramasser, couper, trancher. Vos bouches inventaient des mots ronds comme des fruits. »
Dans une langue pétrie de poésie et d’allégories, Marylise Leroux nous confie le monologue d’une femme meurtrie mais vivante et, dans son sillage, c’est un hymne à toutes ces femmes humbles qui enfantent, nourrissent, protègent et transmettent un savoir ancestral.
Malgré les épreuves, la vie finit par triompher.
Ce long et magnifique poème est un chant émouvant, sombre et semé d’espoir.