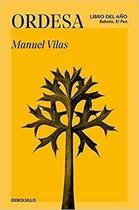Un livre en noir et blanc, splendide et crépusculaire.
« Irene », les tragédies et ses méandres implacables.
Une femme vertigineuse entre la fureur de vivre et l’abîme du désespoir.
La lumière transperce ce récit d’amour.
On pressent l’heure de l’éternité.
Un texte essentiel, une...
Voir plus
Un livre en noir et blanc, splendide et crépusculaire.
« Irene », les tragédies et ses méandres implacables.
Une femme vertigineuse entre la fureur de vivre et l’abîme du désespoir.
La lumière transperce ce récit d’amour.
On pressent l’heure de l’éternité.
Un texte essentiel, une référence, un marqueur dans le monde éditorial.
Irene et Marcelo s’aiment. La banalité est le néant. Le lien qui anime ce couple sensuel est la connivence. Une relation intellectuelle, culturelle, innée, conquise et charnelle.
Le langage des corps qui se retournent à contre-sens et réinventent une cartographie de prodigalité.
L’amour comme une éthique à la beauté. Les sentiments dans une spontanéité des compréhensions du monde. La radicalité vertigineuse d’atteindre le point de non retour.
Mais, Marcelo est malade et va mourir. Le glissement vers la finitude. Un lâcher-prise à la tendresse, aux regards épopées. Irene vacille, se retient à la rampe. La prolifération des douleurs viscérales sont une hantise pour Irene. Mais, plus que tout, elle ne veut pas sombrer. Garder la tête haute. S’enrouler dans les fantasmes, les rêves blessés. Théâtrale et divine, elle va différer l’heure du baisser de rideau.
Vivre dans l’excès, dépenser l’argent commun, s’inventer une vie dédiée à Marcelo, mimétisme. La transmutation dans l’architecture corporelle de ses amants. L’élixir dramatique, avant la chute fatale de la falaise.
« Il lui semblait entendre Marce. Tout ce que racontait Julio aurait pu sortir de la bouche de son mari… Concevoir une idée aussi belle que « l’excès d’existence », était davantage une particularité de Marce que de Julio… Dormir ensemble est une lutte à deux contre l’obscurité de l’espèce. »
La fatalité d’un drame qui n’en finit pas. Le voyage comme une étoile de mer sur le front de Marcelo, elle devient transhumance, fuite, folie et mirage.
« Marcelo croit voir le Panthéon avec les yeux d’Irene… Ils se sont dit : « Nous sommes amoureux et, comme par hasard, nous côtoyons une civilisation. »
Les allers et retours, entre l’avant et l’après sont un cercle de feu. C’est ici que tout se joue. Irene est brisée et souveraine, diablesse, et repentante. Le manège de sa vie est semé de clowns tristes.
Les souvenirs sont le triomphe de l’instant, la jouissance, un rite pavlovien qui s’éternise.
Elle se noie dans les expériences et balance comme un chiffon, la dépendance.
Il faut que Marcelo soit présent, sur la plus haute marche des escaliers et approuve ce qu’il voit d’elle, devenue. Les psychologies sans avenir, Irene sombre.
« Le désir fait grandir l’âme et maigrir le corps… Si un être humain désire créer de l’art et de la beauté à partir de la mémoire, qui peut le lui interdire ? Pense Irene. »
Irene est comme la pleine lune qui ne ment pas. La nage à contre-sens dans un lac gelé. L’obsession cardinale d’atteindre le rivage d’une renaissance avec Marcelo.
« Tu étais aussi le printemps. Et un enfant. Et un gentleman. Et un éclair. »
C’est un chef-d’œuvre qui brusque l’entendu. Un livre sur le sacrifice et les mécanismes des résistances face à la mort de l’aimé. Les résiliences dans une marche forcée, un contre la montre urgent. Un portrait de femme comme dirait Duras : « Sublime, forcément sublime. »
L’empreinte de la mémoire en plein ciel, comme la signature d’un cerf-volant marginal et osé. Le paroxysme de l’amour.
« Irene », culte et magistral, enchanté et profond, a reçu le prestigieux prix Nadal du meilleur roman espagnol. Après « Ordesa » et « Alégria », Manuel Vilas fait saillir l’émotion. La littérature spéculative.
Traduit avec talent de l’espagnol par Isabelle Gugnon. Publié par les majeures Éditions du sous-sol.