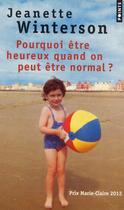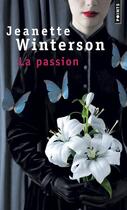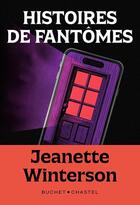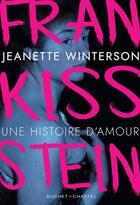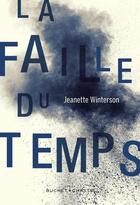D'abord il y a une femme, sonore, immense, "pas à la bonne échelle, plus vaste que nature", un personnage de conte de fées, là "où les proportions sont approximatives et instables". Cette femme, c'est Mrs Winterson, la mère de l'auteur, plus précisément sa mère adoptive car il y a aussi, comme...
Voir plus
D'abord il y a une femme, sonore, immense, "pas à la bonne échelle, plus vaste que nature", un personnage de conte de fées, là "où les proportions sont approximatives et instables". Cette femme, c'est Mrs Winterson, la mère de l'auteur, plus précisément sa mère adoptive car il y a aussi, comme une ombre en creux, la mère biologique, trop jeune à la naissance de son bébé et qui l'a confiée à l'adoption. Mais si ce pâle fantôme traverse le roman, il n'est pas de taille à rivaliser contre l'envahissante, volumineuse et autoritaire Mrs Winterson, "une femme qui passait ses nuits à faire des gâteaux pour ne pas avoir à dormir dans le même lit que mon père. Une femme qui avait une descente d'organes, une thyroïde déficiente, un coeur hypertrophié, une jambe ulcéreuse jamais guérie, et deux dentiers — un mat pour tous les jours et un perlé pour les grands jours". En proposant d'emblée au lecteur, pour préambule de son récit d'enfance, le portrait de cette femme bigote pentecôtiste, oppressante, déséquilibrée, aux avis tranchés et aux préjugés tenaces, Jeanette Winterson présente le personnage central et donne le ton de ses confidences sans complaisance.
Née en 1959 à Manchester, adoptée par les Winterson à "plus de six semaines mais moins de six mois", Jeanette vit jusqu'à l'âge de 18 ans à Accrington, petite ville industrielle du Lancashire, entre une mère tyrannique et un père effacé. La petite maison est remplie d'interdits et de punitions mais vide d'amour et de livres. Entre elle et sa mère "l'amour n'était pas une émotion ; c'était le terrain miné qui (les) séparait". Et pour des raisons obscures et absurdes, tout livre est banni. Pour assouvir son désir d'évasion, il ne reste donc à la jeune fille que la bibliothèque municipale où elle lit de façon intensive et déterminée tous les livres de littérature anglaise, de A à Z. C'est ainsi qu'elle découvre qu'un "livre est un tapis volant qui vous emporte loin. Un livre est une porte. Vous l'ouvrez. Vous en passez le seuil." Et vous n'en revenez pas. "La littérature et la poésie sont des médicaments, des remèdes. Elles guérissent l'entaille pratiquée par la réalité sur l'imagination."
C'est donc une mélodie sur deux tons que Jeanette Winterson compose son récit. Un ton âpre, cru, truculent, teinté d'une ironie mordante et cruelle, pour les épisodes de son enfance, le portrait de sa mère, les blessures et les humiliations. Et un ton doux, rêveur, poétique, inspiré, passionné, pour toutes les réflexions sur l'écriture, la littérature et l'amour.
Grâce à cette double tonalité, l'auteure nous fait pleinement ressentir la distance entre elle et sa mère, une distance qui ne cessera de se creuser et qui est tout entière résumée dans la phrase lapidaire prononcée par la mère à sa fille qui tente d'expliquer, de "justifier" son homosexualité en invoquant le bonheur : "pourquoi être heureux quand on peut être normal ?" Cette interrogation jetée sur le pas de la porte est bien plus profonde qu'il n'y paraît car tout est dit des visions antagonistes des deux femmes. La mère n'aspire qu'à être normale quand la fille ne désire rien d'autre qu'être heureuse. Cette interrogation vient placer aussi au second plan le récit cette l'enfance malheureuse vécue dans une sorte de "conspiration du silence" pour mettre au premier plan le thème essentiel de cet ouvrage : l'émancipation, le chemin vers une libération, long et difficile tant il est vrai qu'il "faut beaucoup plus de temps pour s'extirper du lieu psychique que du lieu physique". Même hors du foyer familial étouffant – "mon père était malheureux, ma mère était dérangée. Nous étions des réfugiés dans notre propre vie" – il faudra du temps à Jeanette pour parvenir à la libération de son corps et des carcans sociaux, de la révélation de son homosexualité au choix de son destin. S'émanciper, s'assumer seule, satisfaire sa soif de savoir, oser écrire et devenir écrivain. Découvrir que le langage littéraire, davantage encore que la littérature est le point d'ancrage et le point d'horizon de cette libération. Vivre l'amour aussi, "l'amour. Le mot difficile. Où tout commence, où tout revient toujours. L'amour. Le manque d'amour. La possibilité de l'amour."
Récit autobiographique, récit d'initiation et de retrouvailles, manifeste féministe et féminin, l'ouvrage de Jeanette Winterson est aussi, surtout, une ode aux mots, à la lecture et à l'écriture. "Il m’a fallu beaucoup de temps pour comprendre qu’il existe deux types d’écriture ; celle que l’on écrit et celle qui nous écrit. Celle qui nous écrit est dangereuse. Nous allons là où nous ne voulons pas aller. Nous regardons où nous ne voulons pas regarder". C'est pour cela qu'il est urgent, impératif, d'écrire. D'écrire sa vie, de s'écrire soi, d'écrire le monde.
"Raconter une histoire permet d'exercer un contrôle tout en laissant de l'espace, une ouverture. C'est une version mais qui n'est jamais définitive. On se prend à espérer que les silences seront entendues par quelqu'un d'autre, pour que l'histoire perdure, soit de nouveau racontée. En écrivant, on offre le silence autant que l'histoire. Les mots sont la part du silence qui peut être exprimée."