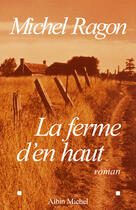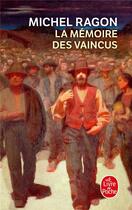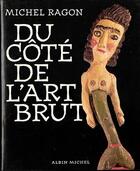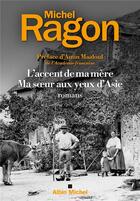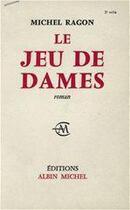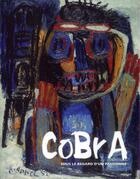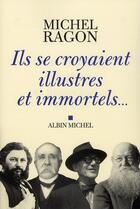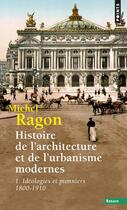Aujourd’hui, l’art brut est une notion artistique plus ou moins bien intégrée par le grand public. Mais, au début, ce n’était que le résultat des prises de position et des recherches de Jean Dubuffet (1901-1985) pour trouver de nouvelles formes d’expression esthétique, loin de tout art officiel....
Voir plus
Aujourd’hui, l’art brut est une notion artistique plus ou moins bien intégrée par le grand public. Mais, au début, ce n’était que le résultat des prises de position et des recherches de Jean Dubuffet (1901-1985) pour trouver de nouvelles formes d’expression esthétique, loin de tout art officiel. Et le terme générique d’art brut d’apparaître en 1945. D’ailleurs, le peintre Gaston Chaissac (1910- 1964) ne disait-il pas « L’art brut, Dubuffet en est le maître-queux (alors que je n’en suis que le marmiton) » ? En effet, le peintre du Havre fut le premier à rassembler des œuvres d’art, à recueillir ce qui n’avait suscité que guère d’intérêt jusque-là : des dessins d’enfants, des œuvres d’art populaire, des peintures d’aliénés … Et dans la foulée, il créa la Compagnie de l’art brut.
Le critique (mais également historien d’art) Michel Ragon nous retrace ici l’histoire et les aspects de cette démarche, tout en restant lucide face à ses limites, à ses dérives, à ses impasses. Il consacre de belles pages aux principales personnalités du courant : Aloïse, Chaissac, le facteur Cheval, Darger, Forestier, Lesage, Adolf Wölffli … L’une des grandes qualités de cet ouvrage est d’éviter l’écueil habituel : pour beaucoup, l’art brut est l’art des fous, ce qui est stigmatisant pour une grande partie des œuvres et, me semble-t-il, injuste. Donc même si Ragon consacre une part importante à Dubuffet et une autre à Chaissac (qui a une place à part, selon moi, car il a exposé, voulu avoir une reconnaissance du milieu, écrit des textes, etc.), il n’hésite pas à développer des aspects esthétiques du travail d’Aloïse Combaz et de Wölffli, pour ensuite s’émerveiller devant le Palais idéal du facteur Cheval. Enfin, il développe les motivations de la Fabuloserie, un musée de l'art brut, situé à Dicy dans l’Yonne. Ce qui m’a fait penser aux expositions de « art)&(marges musée», un Centre de Recherche et de Diffusion d'art outsider (selon leurs propres mots ) qui défend des artistes qui ne s'inscrivent pas dans le circuit culturel officiel. Il se trouve au 312-314, rue Haute à Bruxelles. Et il mérite véritablement le détour.
Un petit reproche : la qualité des illustrations n'est pas toujours bien choisie, de piètre qualité, ou en noir et blanc là où la couleur aurait été la bienvenue.