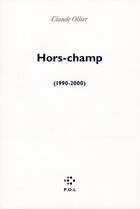« […] les mots ne dépendent pas de ce que croit dire celui qui les dit : les mots disent ce qu’ils deviennent, ils racontent toujours une histoire, des histoires. »
Les mots de Santiago H.Amigorena glissent un pied dans la porte de l’histoire verrouillée de silence de sa famille. Lorsque Vicente Rosenberg, son grand-père, quitte Varsovie en 1928 pour aller s’installer en Argentine, il n’est pas (et il ne peut pas être, pas encore, pas si tôt !) un juif qui fuit la menace nazie, il n’est qu’un jeune homme comme tant d’autres, gonflé de l’espoir de construire sa vie dans un pays plein d’avenir et, surtout, loin de l’amour étouffant de sa mère. Alors, oui, il répond à ses lettres, mais pas toujours, mais de loin en loin, mais de moins en moins. Jusqu’à ce que des mots terribles, des mots qui seront les derniers, tracent les contours d’une réalité qu’il ne voulait pas voir, qu’il ne pouvait pas croire et contre laquelle il ne peut plus rien. Alors, de douleur et d’impuissance, il se tait.
L’histoire que racontent les mots de Santiago H.Amigorena est, paradoxalement, celle d’un silence qui se creuse dans le fracas lointain des armes, dans la douleur montante des larmes, dans la terreur sournoise des flammes d’une terre brûlée à venir. Celle d’un silence qui se bâtit, à grand renfort de honte et d’angoisse sur les ruines encore fumantes d’une existence dont on ne soupçonnait pas la valeur, de souvenirs dont on ignorait qu’on les chérissait. Les mots de Santiago H.Amigorena racontent un gouffre qui se creuse, un mur qui se construit, un silence qui se fige peu à peu entre le racontable et l’indicible, entre ce que les mots peuvent traduire et ce qu’aucun d’entre eux, jamais, n’aura le pouvoir de dire avec assez de force, de poids, d’horreur et de justesse. Ils racontent l’histoire du nouveau péché originel, celui de la génération « d’après », entravée pour toujours des chaînes de la culpabilité d’avoir échappé au pire, de n’avoir pas su le voir, le dire et d’avoir osé vivre tandis que tant d’autres mourraient. Les mots de Santiago H.Amigorena racontent le silence coupable de ceux qui n’ont pas voulu croire aux mots qui racontaient et qui donnaient à voir et à hurler, le silence qui enferme et qui tue, le silence qui condamne. Qui « damne avec » ?
En retrouvant les mots enfouis, les mots qui n’ont pu être dits avant lui, Amigorena dévoile, avec justesse et une douloureuse lucidité, la Genèse d’un silence qui, à votre tour, vous laissera sans voix.